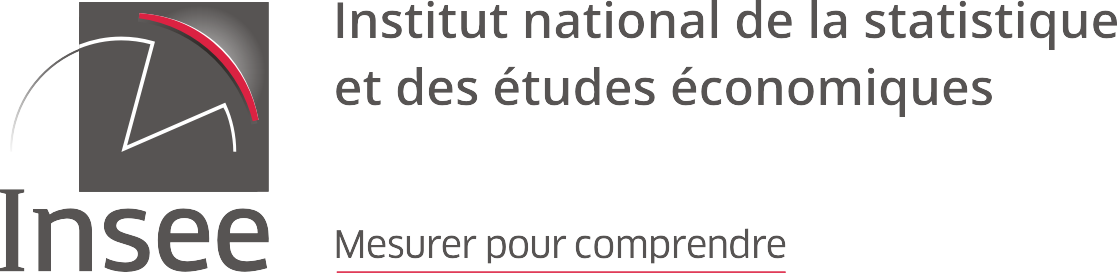Appui technique international Lettre d’information n° 18, juin 2022
Appui technique international Lettre d’information n° 18, juin 2022
- Éditorial
- Le PAS2, c’est parti !
- Tunisie : succès du projet Nouvelle Base pour les comptes nationaux
- Entretien avec Pierre Muller et Louis Bê Duc, experts du projet Nouvelle Base
- STEP : un succès malgré des conditions de déploiement difficiles
- La découverte en Arménie des missions d’appui technique
- Le nouveau numéro de Statéco, spécial GPS
- En bref – les activités de coopération au 1er semestre 2022
- Activités régionales
- Afrique sub-saharienne
- Maghreb et bassin méditerranéen
- Europe et Asie
Éditorial
La levée progressive des restrictions liées à la crise sanitaire s’est poursuivie, permettant la mise en place d’un mode hybride de coopération technique donnant toute sa place aux activités sur site en synergie avec les actions virtuelles. Un équilibre est encore à trouver mais une dynamique est enclenchée et le choix est aujourd’hui plus large entre les modalités d’appui technique les plus appropriées aux objectifs recherchés, au public à atteindre et à la disponibilité des experts.
Ce numéro s’ouvre sur le nouveau Programme statistique pan-africain financé par l’Union européenne (le PAS2), où la phase de démarrage constitue une étape essentielle pour le choix des activités qui seront menées, leur public cible et la constitution de l’équipe de coordination. Ensuite, un point est fait sur l’achèvement du projet Nouvelle Base avec l’INS de Tunisie. Il marque l’achèvement du changement de base des comptes nationaux tunisiens et l’intégration du nouveau système de comptabilité nationale (SCN 2008), après trois années de coopération bilatérale avec l’Insee qui a pris la suite du jumelage européen qui s’est tenu de 2016 à 2018. Cette réussite est l’occasion de s’entretenir avec les experts du projet sur cette expérience et leur appréciation de la coopération technique d’une manière générale.
Le programme européen STEP au bénéfice de six pays du voisinage Est de l’Union européenne s’achèvera prochainement : nous présentons un bilan de la participation de l’Insee et interrogeons nos experts de retour de mission en Arménie sur leur découverte de l’appui technique international. Cette Lettre d’information présente enfin le prochain numéro spécial de la revue Stateco consacré à la thématique Gouvernance, paix et sécurité, ainsi qu’un recensement des activités menées au second semestre 2021.
Nous vous souhaitons une excellente lecture.
Le PAS2, c’est parti !
Le Programme statistique panafricain (PAS2), financé par la Commission européenne, a débuté en février pour une durée de près de 4 ans (2022-2025). La phase de démarrage des projets de subventions auxquels participe l’Insee, qui s’est achevée fin juin, a eu plusieurs objectifs : (1) sensibiliser les pays de l’Union africaine au projet ; (2) pré-identifier, pour chaque composante, les pays qui bénéficieront des différentes activités ; (3) établir des classifications des INS du point de vue de leurs capacités et de leur niveau de développement au regard des thématiques abordées (notamment en comptabilité nationale) ; enfin (4) identifier les besoins des pays pour chacune de ces thématiques.
Cinq types d’activités ont été mises en œuvre dans le cadre de la phase de démarrage, qui ont chacune concouru à un ou plusieurs de ces objectifs : des réunions de lancement ; des actions de communication ; des rencontres avec des partenaires internationaux de la statistique africaine ; l’envoi d’un questionnaire aux INS africains ; enfin, deux missions pays.
Des réunions de lancement avec tous les partenaires
Des réunions de lancement des deux projets de subventions sur les statistiques économiques et d’entreprises et sur les statistiques sociales ont été organisées au siège de l’Insee du 1er au 3 mars derniers. Ces réunions ont aussi été l’occasion de réfléchir à la coordination entre les projets de subventions et le contrat de services (coordonné par Expertise France), ainsi qu’à la préparation de la phase de démarrage. L’ensemble des INS européens partenaires (outre la France, Danemark, Espagne, Finlande, Norvège et Pologne) ont participé à ces réunions, ainsi qu’Eurostat. Tous les INS ont exprimé le souhait d’être associés à l’organisation du Hackathon sur l’utilisation des sources alternatives de données, activité proposée par l’Insee et qui couvre les deux projets de subventions.

Sur la photo : Participants aux réunions de lancement en présentiel – représentantes
des INS
du Danemark, de Finlande, de Norvège et de Pologne et de l’Insee. Représentant
d’Eurostat
Etaient également présents à distance des représentants de l’INE (Espagne), d’Eurostat,
de Statafric et
l’équipe Expertise France en charge du contrat de service PAS2.
Des activités de communication pour donner de la visibilité au projet
A l’initiative de l’Insee, un événement parallèle (« side event ») de la Commission Statistique des Nations unies a été organisé le 14 mars dernier , en collaboration avec Eurostat et l’Union africaine. Cet événement (organisé en visio-conférence) a réuni 94 participants dont des représentants de 24 pays africains et de 11 organisations internationales ou régionales. A l’issue de l’événement, une douzaine de pays ont exprimé leur intérêt pour participer à un des projets de subventions.

Le programme a également été présenté lors de la dernière réunion des 30 et 31 mars derniers du groupe Eurostat sur la coopération internationale (Management Group for Statistical Cooperation). L’ensemble des services de coopération internationale des INS européens ont pu prendre connaissance des différentes composantes du programme PAS2.
Des échanges avec les organisations internationales partenaires de la statistique africaine
Des rencontres virtuelles bilatérales ont été organisées avec les organisations suivantes :
Commission économique pour l’Afrique des Nations unies (UNECA), Banque africaine de
développement, PARIS21, AFRISTAT, agences régionales du FMI en Afrique (AFRITAC),
Banque mondiale, Partenariat global pour les données du développement durable (DATA4SDG).
Elles ont permis d’identifier les projets dont bénéficient déjà les INS africains et de comprendre les modes d’intervention des parties prenantes. Dans le domaine de la comptabilité nationale elles ont contribué à l’élaboration d’une classification des pays selon plusieurs critères (application du SCN 2008, outil utilisé pour la production des comptes, développements en cours et projets) qui sera utile pour définir les pays qui bénéficieront des différentes activités en comptabilité nationale en évitant les duplications avec les projets en cours des autres partenaires.
Un questionnaire aux INS africains pour confirmer leur intérêt pour le projet
Un questionnaire conçu par l’Insee a été diffusé par STATAFRIC aux Directeurs généraux des INS africains pour qu’ils proposent les thématiques sur lesquelles ils souhaiteraient travailler. 36 réponses ont été reçues. Elles ont permis d’élaborer une cartographie des pays qui a été la base d’échanges virtuels avec les INS répondants pour cibler leur participation aux différents types d’activité.
La plupart des activités sont conçues pour s’adresser dans un premier temps à un public large (formations en ligne ouvertes à l’ensemble des participants, ateliers de présentation). Un deuxième type d’activité s’adressera à un ensemble plus restreint de pays (visites d’études, ateliers spécialisés) et mènera à la sélection d’un petit nombre d’entre eux qui bénéficieront d’une assistance technique bilatérale. A la fin du projet, à nouveau, une ouverture s’opérera vers un ensemble plus large de pays sous la forme d’ateliers de partage d’expériences.
Deux missions pays
Deux missions d’étude ont été conduites par les coordinatrices de chacun des deux projets de subventions (Insee et Statistiques Danemark) au Sénégal et au Rwanda. Les éléments recueillis lors de ces missions dans ces deux pays pris comme exemples permettront d’affiner et d’orienter les appuis prévus (notamment le contenu des formations) pour être au plus près des préoccupations de nos partenaires africains. Ainsi, lors de la mission au Sénégal ont pu être précisées les activités prévues sur les comptes nationaux et les répertoires d'entreprises, domaine dans lequel l'ANSD est en pointe. Les échanges avec le National Institute of Statistics of Rwanda (NISR) ont également permis d’avancer dans la préparation des activités prévues sur les sources alternatives de données, le NISR étant labellisé « centre régional des données » pour l’Afrique dans le cadre de la plateforme des Nations unies pour les données massives.

De gauche à droite : Oumar Dia et Awa Diop (ANSD),
Dominique Francoz (Insee), Nina von Lachmann-Steensen (Statistics Denmark),
Allé Nar Diop (Directeur général de l’ANSD), Meissa Ndour (ANSD)
Tunisie : succès du projet Nouvelle Base pour les comptes nationaux
Fin 2021, l’INS de Tunisie a réussi son changement de base des comptes nationaux (de 1997 à 2015-2016), et a intégré le nouveau système de comptabilité nationale (le SCN 2008), objectifs principaux du projet Nouvelle Base entrepris avec l’Insee et la Banque de France en 2019 dans le prolongement d’un jumelage européen. Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, ce succès a été rendu possible par la compétence et l’implication des personnels de l’INS et des experts venus les appuyer : Pierre Muller, inspecteur général honoraire de l’Insee, et, pour les comptes financiers, Louis Bê Duc, responsable de coopération à l’Institut bancaire et financier international de la Banque de France.
Le projet Nouvelle Base visait à appuyer la Tunisie dans l’achèvement des travaux entrepris lors du jumelage mis en œuvre avec l'Insee, l'ISTAT (Institut de statistique de l'Italie) et Statistics Lithuania entre février 2016 et avril 2018, avec la contribution de la Banque de France, et financés par l'Union européenne.
Ces travaux étaient prioritaires pour l’INS : la précédente année de base était très ancienne (1997), la mise en œuvre des recommandations de la nouvelle norme de comptabilité nationale au niveau mondial (SCN 2008) s’imposait et il était important d'améliorer la prise en compte des activités de l'économie informelle.
Le changement de base a concerné aussi bien les comptes des secteurs et sous-secteurs institutionnels (non financiers et financiers) et les comptes de biens et services que les processus de synthèse des différents types d’opérations, les tableaux de synthèse (TES, TEE et TOF) et l’évaluation des agrégats (PIB, Revenu National…). Les comptes financiers tunisiens incorporent désormais plusieurs sources importantes comme l’exploitation exhaustive des comptes des principales entreprises tunisiennes pour les actions cotées et non cotées, et aboutissent pour la première fois à la production d’un compte de patrimoine financier exhaustif pour tous les secteurs, outre les relations avec le reste du monde.
Le projet a abouti également à des préconisations à court, moyen et long terme, comme l’élaboration de comptes de patrimoine complets ou la mise en place de comptes satellites nouveaux ou enrichis (tourisme, environnement...). Certaines de ces recommandations feront l’objet d’un nouvel appui de l’Insee en 2022 et 2023, dirigé par Pierre Muller.
Prolongé d’un an du fait de la crise sanitaire, le projet a fait l’objet de 4 missions à Tunis et de nombreuses visioconférences et échanges à distance, soit plus de 30 jours/hommes en 3 ans de 2019 à 2021. Il illustre l’importance de projets pluriannuels bilatéraux pour assurer la durabilité des projets d’envergure comme les jumelages européens et achever les travaux ou mettre en œuvre les recommandations issues de ces projets.

Le n°113 de la revue Stateco (2019) est consacré à la Tunisie et fait le point sur le jumelage européen avec l’INS
Entretien avec Pierre Muller et Louis Bê Duc, experts du projet Nouvelle Base


Le projet Nouvelle Base a succédé au jumelage européen qui s’est achevé en avril 2018. Comment avez-vous géré la continuité des deux projets, et la conversion des activités en échanges à distance pour faire face à la la crise sanitaire ?
Pierre : La continuité a été naturelle puisque Nouvelle Base portait sur la finalisation d’une partie des activités du jumelage, qui a laissé une documentation abondante. Il y a eu aussi une continuité humaine, des experts côté Insee et partiellement des équipes côté INS.
Concernant les activités à distance, des réunions courtes et régulières ont permis de garder le contact pendant la crise sanitaire, même si une année a quand même été perdue : les travaux que j’avais à mener se prêtaient peu aux activités à distance.
Louis : Concernant les comptes financiers dont j’avais la charge, la continuité a été favorisée par le fait que des contacts avaient été pris auprès des fournisseurs de données lors du jumelage avec la mise en place de requêtes aux fournisseurs qui ont pu être utilisées de façon complémentaire dès le début de Nouvelle Base. De plus, j’ai pu réaliser une mission sur place au début du projet juste avant les mesures de restriction des transports entraînées par la crise COVID. Les activités à distance ont donc porté sur les fichiers de travail et ont permis d’avancer dans de bonnes conditions. Ces modalités d’assistance technique à distance ont d’ailleurs été généralisées à la Banque de France durant la pandémie.
Quels sont pour vous les avantages et les inconvénients d’un projet multilatéral comme un jumelage par rapport à un projet de coopération bilatérale ?
Pierre : Un jumelage est très structurant, c'est une bonne formule pour enclencher un dispositif, avec des moyens importants et des ambitions fortes dans un laps de temps court. En revanche, le temps de mise en place et de rodage est plus long que dans une coopération bilatérale, qui présente plus de souplesse et d'adaptabilité.
Louis : L’intérêt d’un jumelage ou projet multilatéral est aussi de pouvoir faire intervenir plusieurs institutions et d’utiliser ainsi un pool plus vaste de ressources.
Louis, pendant le projet, vous étiez responsable de coopération à l’Institut bancaire et financier international (Ouvrir dans un nouvel ongletIBFI) de la Banque de France. Comment s’inscrit un projet commun avec l’Insee tel que Nouvelle Base dans la coopération de l’IBFI ?
Louis : Les actions d’appui technique de l’IBFI se déploient le plus souvent dans le cadre de programmes multilatéraux (sous l’égide du FMI ou de l’UE). Nous essayons aussi de collaborer avec l’expertise française. Nouvelle Base s’inscrivait totalement dans cette approche : un partenaire important comme la Tunisie, avec laquelle nous avons un accord de coopération (pour la banque centrale), une collaboration avec l’Insee, acteur majeur de la statistique publique française, et Expertise France, dans le prolongement d’un projet européen.
Comment voyez-vous l'évolution de la coopération technique ?
Pierre : Dans les années 80, pendant sept ans environ, j'ai participé à la mise en place de la 1ère génération des comptes tunisiens. C'était une coopération bilatérale de l'Insee sous l'autorité d'André Vanoli, avec déjà la Banque de France. La coopération n'avait alors pas du tout la même forme qu'aujourd'hui : les experts techniques faisaient des missions plus longues, entre 3 semaines et un mois sur place et non pas une semaine comme aujourd'hui. Il y avait un appui important de l'ambassade de France en Tunisie.
Je dirais que la coopération statistique est appelée à se développer car il y a de nombreux besoins, mais que deux conditions doivent au minimum être réunies : d'un côté, que les institutions bénéficiaires aient assez de disponibilités, avec une stabilité suffisante des équipes sur place et notamment des cadres ; de l'autre, que les organismes fournisseurs aient les moyens des appuis qu'ils proposent. Ainsi, je rappelle qu'une bonne part des experts français du jumelage avec l'INS de Tunisie étainet des retraités de l'Insee : la charge de travail à l'Insee semble importante et s'y ajoute une sollicitation européenne de coopération au sens large de plus en plus pressante. Aussi aujourd'hui il y a des difficultés à la fois du côté de l'offre et de la demande. Et la perception par les cadres de l'Insee de la coopération n'est plus la même qu'avant, même si les nouvelles générations sont plus ouvertes et intéressées. La numérisation peut redonner un souffle en permettant des mobilisations d'experts courtes, mais elle ne permet pas de tout faire.
Louis : Pour ma part je trouve que le numérique ouvre un champ nouveau dans la coopération : il permet de toucher un plus grand nombre de personnes et de répondre de manière flexible aux demandes d’appui technique. Le numérique s’est fortement développé à l’IBFI et nous avons triplé depuis la pandémie le nombre de participants aux séminaires de formation ! C’est une opportunité, et qui s’insère bien aussi dans le développement des collaborations multilatérales. Cela permet aussi de compenser dans certains cas le manque de disponibilité des agents pour des missions sur place. L’IBFI a également développé la diffusion de replays vidéos et de modules d’apprentissage en ligne, à partir de ses actions. Concernant la valorisation des actions de coopération extérieure, si les contraintes de ressources des métiers existent, la participation à ces actions reste valorisée, en tout cas l’IBFI travaille à la promouvoir en interne.
Vous avez mené le projet ensemble, chacun dans votre domaine de compétence. Que retenez-vous de cette collaboration ?
Pierre : C'était très positif, sur le fond et sur la forme. Il y a une continuité dans la stratégie de l'Insee d'associer la Banque de France car une vraie importance est accordée aux comptes financiers et à leur articulation avec les comptes non financiers, ce qui a pu être traité dans le cadre de Nouvelle Base. Et mon entente avec Louis a été complète.
Louis : C’était une très belle expérience, je me suis effectivement très bien entendu avec Pierre. Et j’ai beaucoup appris à ses côtés sur la méthodologie. Il y avait une bonne communication entre nous, sur place avec notamment des réunions communes, et par les rapports de missions, que nous rédigions chacun de notre côté de façon assez complète.
Quelles sont pour vous les clés de la réussite d'un projet comme Nouvelle Base ?
Louis : Je dirais la réalisation d'un projet de moyen terme inscrit dans la durée (échelonné entre 2016-2018 pour le jumelage et 2020-2021) pour Nouvelle Base qui a permis une action cohérente, l'établissement de relations de confiance avec les équipes en place, l'engagement des autres fournisseurs de données, et un transfert de compétence durable.
Pierre : Pour une action bilatérale prolongeant un jumelage, la 1ère clé est pour moi une bonne appréhension de ce qui a été fait : une documentation technique importante et précise permet de limiter le coût d'entrée dans le projet. La 2e se rapporte plus à une bonne connaissance des systèmes internationaux, y compris les parties moins connues comme, en comptabilité nationale, les comptes satellites. Enfin, en 3ème lieu, il est essentiel de fixer des objectifs réalistes par rapport à une situation, mais tout de même ambitieux.
Quelles étaient vos motivations pour participer à ce projet ?
Louis : Etre une belle expérience pour moi et me permettre de combiner (ce qui est souhaité à l'IBFI) des actions d'organisation de la formation avec des actions d'appui technique dans mon domaine de compétence. Cela a été très enrichissant, aussi par les rencontres que cela m'a permis de faire.
Pierre : J'ai un vrai goût pour la coopération, qui me semble essentielle pour un cadre de l'Insee et en particulier pour un comptable national. J'avais un bon souvenir de l'INS tunisien et de la qualité de ses cadres. De plus, Nouvelle base me permettait d'aller au-delà des coopérations classiques sur le cadre central de la comptabilité nationale : boucler un processus d'élaboration de comptes, c'était nouveau. Enfin, cela permattait d'aller au bout du jumelage, dont l'ambition de changer de base en deux ans était illusoire : il fallait 4 ou 5 ans, ce qui s'est produit.
Que diriez-vous à un expert junior qui serait tenté par des activités de coopération internationale ?
Louis : La coopération est utile aux institutions, mais est aussi très enrichissante d'un point de vue personnel. Elle demande de s'adapter aux situations et aux besoins des institutions partenaires, sans vouloir plaquer le système de sa propre institution, d'être curieux et pragmatique. Cela peut être un plus dans un parcours professionnel, car c'est une marque d'ouverture et de dynamisme, et cela permet de créer des contacts utiles auprès des institutions partenaires (bénéficiaires ou pourvoyeuses d'appui technique).
Pierre : Hormis sa propre pratique, pour progresser, il y a les discussions internationales, qui sont très intéressantes. Mais il y a aussi la coopération internationale, très différente : moins formelle, moins conceptuelle, et davantage dans la durée. Elle a ses exigences : les missions sur place sont importantes, même si elles courtes et peu fréquentes. Il faut les préparer, prendre connaissance de l'état statistique du pays, connaître les normes internationales, dont les systèmes nationaux sont issus. On apprend son métier en se confrontant à d'autres expériences.
STEP : un succès malgré des conditions de déploiement difficiles

Nous ne pourrions commencer cet article sans mentionner la stupeur et la tristesse qui sont les nôtres face à la situation actuelle de l’Ukraine, Etat membre du programme STEP. Nous tenons une nouvelle fois à exprimer notre soutien et notre solidarité à nos collègues ukrainiens et à leurs familles. Nous avons été admiratifs devant ceux qui continuaient à travailler et à participer aux activités en ligne malgré ces circonstances extrêmement difficiles. La Biélorussie s'était quant à elle retirée de la participation au programme STEP dès janvier 2022, à la suite de la suspension de sa participation au Partenariat oriental l'été dernier.
Le 31 juillet, le programme STEP – pour Ouvrir dans un nouvel ongletStatistics for the Eastern Partnership - arrivera à son terme. Depuis son lancement en janvier 2019, plus de 70 formations, ateliers et visites d'étude ainsi qu’une trentaine de missions d’assistance technique auront été organisés au bénéfice de 6 pays du voisinage Est de l’Union européenne : Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie et Ukraine. Pourtant, entre la crise mondiale liée au Covid-19 et le contexte régional très difficile, les conditions idéales n’étaient pas réunies pour un bon déploiement. Le programme a su bien s’adapter en convertissant en ligne une très grande partie de ces activités et en demandant une extension de la période d’exécution (fin initialement prévue le 31 octobre 2021).
L’Insee a été l’un des moteurs du projet, aux côtés des INS italien, danois, hongrois et lituanien, sous la coordination d’Expertise France. La France a ainsi contribué à 14 activités, dont la plupart réalisées en visioconférence. Les domaines d’intervention principaux étaient les statistiques d’entreprises, la comptabilité nationale, la qualité et la gouvernance des INS. Malgré la prédominance du mode en ligne, deux activités ont néanmoins pu être réalisées en présentiel : une visite d’étude organisée fin 2019 à Montrouge et une mission d’assistance technique sur la gestion des micro-données de l’enquête emploi en 2022 à Armstat (Arménie) (Julien Jamme et Clément Guillo, voir l’entretien ci-dessous).
La dernière étape pour STEP sera l’organisation de l’événement de clôture qui fera le point sur toutes les avancées réalisées dans ce partenariat. Pour plus d’information et pouvoir consulter certains outputs du programme, rendez-vous sur le Ouvrir dans un nouvel ongletsite du programme STEP.
La découverte en Arménie des missions d’appui technique
Entretien avec Clément Guillo et Julien Jamme

De gauche à droite : l’équipe d’Armstat (INS d’Arménie), Julien Jamme (Insee),
Fenya Yepremyan (interprète) et Clément Guillo (Insee)
Quelles étaient vos motivations pour mener cette mission en Arménie ?
Cette coopération nous a été proposée en début d’année par le département de la coordination internationale et traitait de l’anonymisation des micro-données. Nous y avons vu une opportunité de rencontrer d’autres professionnels se confrontant aux mêmes problématiques que nous. Ceci était une occasion pour nous de réunir, de structurer et de confronter le savoir que nous avions emmagasiné sur le sujet de l’anonymisation dans le cadre de nos travaux méthodologiques. En outre l'Arménie nous semblait être une destination très attractive.
Qu’en retirez-vous sur le plan professionnel et personnel ?
Nous avons eu un échange très enrichissant avec les équipes des statisticiens d’Armstat. Ces derniers se sont montrés très réceptifs au contenu que nous leur proposions. Leurs réactions et questions étaient très pertinentes et pointues, ce qui nous a permis de dégager plus de profondeur sur ce que nous présentions. Nous avons eu le sentiment d’être utiles. En outre nous avons été très bien accueillis par les équipes à notre arrivée et un climat bienveillant très appréciable s’est maintenu pendant ces 3 jours. Nous leur en sommes très reconnaissants.
En quoi ce type de collaboration est-il pour vous spécifique et complémentaire à vos travaux habituels ?
Dans notre section Méthodes de la statistique spatiale et du secret statistique, nous sommes en permanence au contact avec les producteurs de données pour lesquels le problème du secret statistique sur données tabulées se pose. La mission en Arménie nous a permis d’avoir ce rôle de conseil sur les questions d’anonymisation des micro-données. Nos interlocuteurs, assez novices sur le sujet, attendaient de nous des propositions concrètes ainsi que des concepts généraux qui leur permettraient par la suite d’anonymiser toute sorte de micro données. Nous nous sommes donc inscrits pour cette mission dans une position plus stratégique que d’habitude. Nous remercions par ailleurs l'interprète (de l'anglais vers l'arménien) qui a su retransmettre avec brio l'ensemble des concepts, idées et codes que nous présentions.
Le nouveau numéro de Statéco, spécial GPS

Statéco célèbre cette année son 50ème anniversaire. Ce numéro spécial est consacré à la thématique des statistiques sur la gouvernance, la paix et la sécurité (GPS). Il comprend 11 articles écrits par un total de 25 auteurs originaires de pays situés sur trois continents : Afrique (Cameroun, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Madagascar et Mali), Amérique (Brésil, Canada, et Pérou) et Europe (France). Ces auteurs sont des chercheurs (économistes, politologues, etc.) des cadres d’organisations internationales, et des statisticiens.
Les articles de ce numéro sont regroupés en quatre parties. Ceux de la première partie visent à mettre en avant la nécessité de combiner les avancées institutionnelles et techniques pour consolider la place des données GPS dans les systèmes statistiques nationaux. Ceux de la partie suivante portent sur des défis méthodologiques que la mesure des dimensions de la gouvernance soulève. Enfin, les articles présentés dans les troisième et quatrième parties fournissent des illustrations des questions analytiques que les statistiques GPS permettent d’approfondir.
Cette thématique est importante pour l’Insee et pour le service statistique public français, comme le montre l’avant-propos signé par le Directeur général de l’Insee ainsi que l’article de ce numéro rédigé par des statisticiens du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Ce texte est consacré à la Ouvrir dans un nouvel ongletnouvelle enquête annuelle de victimation lancée en 2022 par ce service. Elle remplace l’enquête Cadre de Vie et Sécurité, conduite annuellement depuis 2007 en partenariat avec l’Insee, qui est une des plus anciennes enquêtes régulières sur ces questions au niveau mondial. En outre, la France suit de près les travaux du Ouvrir dans un nouvel ongletgroupe de Praïa sur les statistiques de gouvernance, auquel le premier article de ce numéro spécial est consacré.
Pour célébrer la parution de ce numéro spécial GPS de la revue Statéco, une visioconférence a été organisée les 31 mai et 1er juin 2022. La présentation des articles par leurs auteurs a rassemblé plus d’une centaine de participants issus de la communauté scientifique internationale (chercheurs, statisticiens, politologues, sociologues, décideurs..) des pays d’Afrique francophone, de l’Algérie, du Maroc, de la Tunisie, ainsi que des pays d’Amérique latine, et de la France.
Le Statéco spécial GPS est disponible ici sur le site de l’Insee.

Les participants à la 2ème journée de présentation du Stateco spécial GPS, le 1er juin 2022
En bref – les activités de coopération au 1er semestre 2022
Activités régionales
-
Cycle de conférences thématiques INSEE – AFRISTAT – PARIS21 – UNECA
Webinaires en lien avec le contexte de la crise sanitaire du Covid-19
Pays francophones d’Afrique sub-saharienne et du Maghreb
- Ouvrir dans un nouvel onglet8e webinaire : Les recensements économiques et répertoires d’entreprises : stratégies mises en œuvre et pour quels besoins ?
Février
- Ouvrir dans un nouvel onglet9e webinaire : Construire de meilleures données sur le genre en Afrique : défis et perspectives
Juin
-
INSEE - AFRISTAT
La Revue par les Pairs du système statistique public : un puissant levier pour la qualité :
- La visite par les pairs : préparation des INS et des systèmes statistiques nationaux (en amont et pendant la visite)
- Le rapport d’audit et les recommandations : appropriation et communication par les INS au sein du système statistique national
- La mise en œuvre du plan d’actions : défis et enjeux pour la statistique publique
Panel avec les directeurs généraux de l’INS du Bénin, de Tunisie, d’Afristat et de l’Insee
Juin

Le panel des Directeurs généraux : Jean-Luc Tavernier (Insee), Paul-Henri Nguema Meye
(Afristat),
Adnen Lassoued (Tunisie), Laurent Mahounou Hounsa (Bénin)
Le modérateur : Philippe Gafishi (Paris21)
Afrique sub-saharienne
-
AFRISTAT – EXPERTISE FRANCE- INSEE- FERDI- DGFiP - DGDDI
Visite d’études sur les méthodologies d’enquêtes sur les technologies de l’information et de la communication (TIC) dans le cadre du projet régional d’Appui au renforcement des statistiques de l’économie numérique et d’accompagnement à l’utilisation de la science des données par les administrations fiscales et douanières (DATAFID)
Visite
Juin
-
AFRISTAT
Participation à la formation Leadership statistique organisé à Kigali (Rwanda)
Atelier régional
Mai
-
SÉNÉGAL
Présentation du répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP)
Visite
Mai
-
ILE MAURICE
Visite de M. Dr Renganaden Padayachy, Ministre des finances, de la planification et du développement économique
Mars

M. Jean-Luc Tavernier, Directeur général de l’Insee,
et M. Dr Renganaden Padayachy, Ministre des finances,
de la planification et du développement économique de l’Ile Maurice
Maghreb et bassin méditerranéen
-
ALGÉRIE, MAROC
Le standard international d’échange d’informations SDMX
Office national des statistiques d’Algérie, Haut-Commissariat au plan du Maroc
Formation en visioconférence
Mai
-
ALGÉRIE
Les clés pour préparer une infographie pour le web
Les objectifs des infographies, les techniques de rédaction avec infographies, le référencement ; mise en pratique
Formation en visioconférence
Mars
-
MAROC
Projet Hakama II

Projet triennal sur le renforcement des capacités du Haut-Commissariat au Plan, 3 composantes :
1. Renforcement des capacités techniques des services extérieurs
Communication - Mise en place d’enquêtes de satisfaction
Formation à Lime Survey
Visioconférences, échanges à distance
Janvier
Renforcement des capacités en matière de réalisation d’enquête
Mise en place d’une enquête locale portant sur le chômage
Mission à la Direction régionale de l’Oriental (Oujda)
Mars
Gouvernance – mise en place d’un schéma organisationnel / appui à l’automatisation
progressive des échanges avec les producteurs
Communication - améliorer et uniformiser les publications
Visioconférences, échanges à distance
Janvier-juin
2. Mise en place d’enquêtes multimode
Enquête pilote sur l’emploi par téléphone
Mission à Rabat, visioconférences, échanges à distance
Janvier-juin
3. Refonte du système de production des statistiques d’entreprises
Refonte des enquêtes structurelles : exploitation des sources administratives,
révision générale des méthodologies, mise en place d’une enquête pilote, formation
à R
Deux missions à Rabat ; visioconférences, échanges à distance
Janvier-juin
Comité technique du projet Hakama II
Mission à Rabat
Mars
Les participants au Comité technique d’Hakama II à Rabat, le 10 mars 2022

Indicateur synthétique du climat des affaires
Les indicateurs synthétiques de l’Insee : vue d’ensemble et méthodologie
Mise en place d’un indicateur synthétique du climat des affaires au HCP
Visioconférence
Avril
-
TUNISIE
Identification en vue de l’implantation d’ERETES, application informatique de comptabilité nationale
Présentation du fonctionnement du système aux comptables nationaux tunisiens, proposition d’une organisation adaptée à l’élaboration des comptes nationaux annuels de la Tunisie
Mission à Tunis
Juin
Europe et Asie
- Statistiques pour le partenariat oriental (STEP)
Gestion des micro-données de l’enquête emploi (LFS)
Présentation des méthodes française d'anonymisation et de protection des micro-données,
audit et recommandations sur la méthode arménienne.
Mission à Erevan, Arménie
Mai
Ateliers les statistiques démographiques
Présentation de l'expérience française, échanges et analyse de cas pratiques
sur la gestion de registre de la population et sur la méthodologie des projections
démographiques.
Ateliers en ligne
Mai
Registre statistique des entreprises
Mission en ligne visant à examiner et explorer des méthodologies permettant d’identifier
les entreprises à croissance rapide et les entreprises créées par de jeunes entrepreneurs
en Géorgie.
Visioconférences
Mai
Statistiques d’entreprises
Mission en ligne visant à établir un diagnostic et à produire des recommandations
spécifiques pour l'alignement des statistiques sur les entreprises de l'Azerbaïdjan
sur les normes européennes et internationales.
Visioconférences
Mai
- TURQUIE
Les prix à la production
Mission sur l'indice des prix à la production dans le secteur de la construction
Ankara
Juin
- UKRAINE
Conférence de l’association internationale des statistiques officielles (Ouvrir dans un nouvel ongletIAOS)
Financement de la participation de trois collègues ukrainiennes au 18ᵉ congrès
de l’IAOS à Cracovie intitulé Worthy Information for Challenging Times
Conférence
Avril