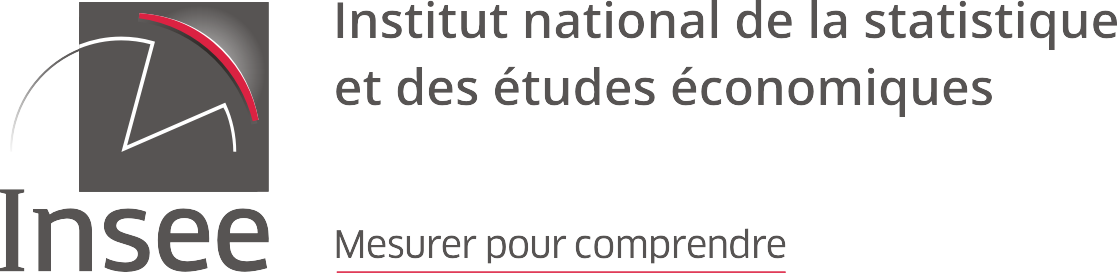Femmes et hommes en début de carrière Les femmes commencent à tirer profit de leur réussite scolaire
Femmes et hommes en début de carrière Les femmes commencent à tirer profit de leur réussite scolaire
Depuis 25 ans, en métropole, les taux de chômage des femmes et des hommes en début de vie active se sont rapprochés. Les jeunes femmes ont même désormais un léger avantage en matière de chômage grâce à leur niveau de formation plus élevé que celui des hommes. Toutefois, à niveau de diplôme identique, le taux de chômage des jeunes femmes reste souvent plus élevé et leurs salaires sont inférieurs à ceux des hommes. En effet, les spécialités de formation qu’elles choisissent ne correspondent pas toujours aux besoins du marché du travail.
En 2008, à diplôme et spécialité équivalents, les taux de chômage des débutants et des débutantes sont très proches, la crise affectant davantage les jeunes hommes.
- En début de vie active, les femmes sont moins souvent au chômage que les hommes
- Les jeunes femmes ont un niveau de formation plus élevé
- Le temps partiel explique une grande partie des écarts de salaires en début de vie active
- À niveau de formation identique, les jeunes hommes s’insèrent souvent mieux
- Vers une plus grande égalité des chances en termes d’emploi pour les débutantes et les débutants
- La crise touche plus les hommes que les femmes, notamment chez les débutants
En début de vie active, les femmes sont moins souvent au chômage que les hommes
En 2008, le taux de chômage des femmes ayant terminé leurs études depuis moins de six ans s’établit à 14 %. Le taux de chômage de leurs homologues masculins est plus élevé (16 %). Ce résultat est le fruit d’une lente évolution (graphique 1). En 1984, les femmes en début de vie active étaient nettement plus au chômage (29 %) que les jeunes hommes (20 %). L’écart entre les hommes et les femmes a progressivement diminué jusqu’en 2002, où les taux de chômage des deux sexes en début de vie active se sont rejoints. Depuis 2007, en début de carrière, le taux de chômage des femmes est plus faible que celui des hommes.
Toutes générations confondues, la tendance est la même : les taux de chômage des hommes et des femmes ne cessent de se rapprocher. En 2008, 7 % des hommes sont au chômage, chiffre légèrement plus faible que celui des femmes (8 %).
Si les femmes sont avantagées en termes de chômage en début de vie active, il n’en est pas de même en matière d’activité : le taux d’activité des jeunes femmes (86 %) reste inférieur de six points à celui des hommes, notamment du fait de la faible présence sur le marché du travail des femmes sans diplôme.
graphiqueGraphique 1 – Taux de chômage des débutants et de l'ensemble des actifs

- * Voir définitions.
- Note : les taux de chômage présentés correspondent à l'interprétation française du chômage BIT jusqu'en 2002 ; à partir de 2003, ils correspondent à l'interprétation communautaire d'Eurostat.
- Champ : France métropolitaine.
- Source : Insee, enquêtes Emploi.
Les jeunes femmes ont un niveau de formation plus élevé
Depuis 25 ans, les femmes n’ont cessé de creuser l’écart avec les hommes en matière d’études. En 1984, seulement 19 % des garçons et 20 % des filles, entrés dans la vie active depuis moins de six ans, possédaient un diplôme de l’enseignement supérieur (graphique 2). En 2008, 37 % des garçons et 51 % des filles sont diplômés de l’enseignement supérieur. Le niveau de formation des filles a plus progressé. Depuis le début des années 2000, 30 % des filles possèdent même un diplôme de l’enseignement supérieur long (diplôme de niveau supérieur à bac + 2). Les garçons peinent à élever leur niveau de formation. En début de vie active, 19 % des garçons n’ont aucun diplôme et cette proportion ne diminue pas depuis 1999. En revanche, la proportion des filles sans diplôme continue de régresser : en 2008, 12 % des jeunes femmes sont sans diplôme ; elles étaient 16 % en 1999. Cette réussite croissante des filles en matière de formation favorise leur insertion professionnelle. Femmes ou hommes, les diplômés de l’enseignement supérieur sont relativement protégés du chômage au cours de leurs six premières années de vie active, contrairement aux jeunes sans diplôme (taux de chômage respectivement de 7 % et 37 % en 2008).
Les filles accèdent plus facilement à des emplois qualifiés grâce à leur niveau de formation plus élevé. En 2008, 48 % des jeunes filles occupent une profession intermédiaire ou un emploi de cadre, contre 43 % des garçons. La situation des filles a bien changé depuis 1984, année où seulement 30 % des filles occupaient de tels emplois contre 33 % des garçons.
graphiqueGraphique 2 – Le niveau de formation des filles a plus progressé que celui des garçons

- Note : la mise en place de l'enquête Emploi en continu entraîne un changement de série à partir de 2003.
- Champ : France métropolitaine.
- Source : Insee, enquêtes Emploi.
Le temps partiel explique une grande partie des écarts de salaires en début de vie active
Pendant leurs six premières années de vie active, les hommes ont des salaires médians supérieurs de 10 % à ceux des femmes : 1 380 euros par mois, toutes primes comprises, pour les hommes et 1 260 euros pour les femmes en 2008.
Les écarts de salaire entre hommes et femmes débutants sont les plus élevés aux deux extrémités des niveaux de diplôme (sans-diplôme et diplômés du supérieur long). En moyenne entre 2003 et 2008, les hommes non diplômés gagnent en début de vie active 23 % de plus que les femmes de même niveau. Chez les diplômés du supérieur long, cet écart est de 21 % ; mais il se réduit à 7 % parmi les titulaires d’un diplôme de niveau bac + 2.
Le temps partiel explique une partie des différences de salaires. Une jeune femme sur cinq travaille à temps partiel, contre seulement un jeune homme sur quinze. À temps plein, le salaire médian des femmes rejoint celui des hommes en début de vie active (autour de 1 400 euros), bien que ces derniers soient moins diplômés. Chez les sortants de l’enseignement secondaire qui travaillent à temps plein, les écarts de salaires entre les sexes se limitent à 7 %, y compris parmi les sans-diplôme. Chez les diplômés du supérieur, le temps partiel est peu fréquent et n’explique qu’une faible partie des écarts salariaux.
Tous âges confondus, l’écart de salaires en faveur des hommes est plus important : + 19 % tous emplois confondus, + 12 % à temps plein.
Pendant leurs six premières années de vie active, les femmes sont moins au chômage que les hommes mais plus souvent en situation de sous-emploi. En 2008, 11 % des débutantes occupant un emploi souhaitent travailler davantage contre seulement 4 % des débutants. Parmi les jeunes femmes sans diplôme ou titulaires d’un Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ou d’un Brevet d’études professionnelles (BEP), un tiers travaille à temps partiel et parmi elles, les deux tiers souhaiteraient travailler davantage.
À niveau de formation identique, les jeunes hommes s’insèrent souvent mieux
À l’issue de l’enseignement supérieur, le taux de chômage des femmes (8 % en 2008) reste supérieur à celui des hommes (7 %) pendant les cinq premières années de vie active. Après un CAP, un BEP ou un baccalauréat, les filles sont aussi plus souvent au chômage (19 %) que les hommes (16 %).
Pendant leurs études, les filles choisissent rarement une spécialité de la production ou des sciences exactes. Or, ces spécialités de formation conduisent en général à une meilleure insertion professionnelle que celles des services ou des sciences humaines et sociales. De plus, lorsqu’elles choisissent une spécialité de la production, les filles s’insèrent en moyenne moins bien que les garçons, les spécialités choisies étant parfois peu porteuses (tableau).
Parmi les titulaires d’un CAP ou d’un BEP de la production, seulement 13 % des diplômés sont des filles. Elles choisissent parfois une formation en textile, en habillement ou cuir, dont les débouchés sont plus rares. 33 % des filles titulaires d’un CAP ou d’un BEP travaillent à temps partiel en début de vie active, contre seulement 6 % des garçons. Tous emplois confondus, les garçons possédant un CAP ou un BEP gagnent 20 % de plus que les filles. À temps plein, le salaire des garçons reste supérieur de 12 % à celui des filles.
Parmi les titulaires d’un baccalauréat général, les taux de chômage des deux sexes sont proches mais les garçons perçoivent des salaires médians supérieurs de 17 % à ceux des filles, dont plus du quart travaillent à temps partiel. Pour un emploi à temps plein, les garçons possédant un bac général gagnent encore 8 % de plus que les filles. Parmi les bacheliers professionnels, les garçons choisissent fréquemment une spécialité de la production et évitent plus souvent le chômage que les filles.
Les jeunes titulaires d’un Brevet de technicien supérieur (BTS) ou d’un Diplôme universitaire de technologie (DUT) ont un taux de chômage similaire quel que soit leur sexe mais les hommes gagnent 16 % de plus que les femmes car leurs emplois sont plus qualifiés.
Parmi les jeunes titulaires de Diplôme d’études universitaires générales (Deug) et de licence (professionnelle ou non), les femmes s’insèrent mieux que les hommes et leurs salaires sont identiques. Les femmes titulaires d’une licence accèdent plus souvent que les hommes aux postes d’enseignants, notamment de professeurs des écoles.
À l’issue des masters et des thèses (hors santé), les taux de chômage sont proches mais les hommes touchent des salaires supérieurs de 16 % à ceux des femmes. Le temps partiel n’explique pas à lui seul cet écart.
Hommes ou femmes, les diplômés des formations paramédicales et de la santé s’insèrent très favorablement, grâce au numerus clausus. Les femmes sont majoritaires dans ces formations, ce qui compense en partie leur faible présence dans les spécialités de la production.
tableauTableau – Pour s'insérer, les garçons tirent profit des spécialités de la production et les filles des formations paramédicales et sociales
| Part des femmes (en %) | Taux de chômage BIT* (en %) | Part d’emplois à temps partiel (en %) | Part des emplois de cadres et des professions intermédiaires (en %) | Salaire mensuel médian* net en 2008 (en euros constants) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||
| BEPC, CEP, sans diplôme | 41,8 | 36,1 | 39,6 | 11,4 | 40,2 | 9,2 | 12,3 | 1 110 | 905 | |
| CAP, BEP et équivalent | Production | 12,9 | 17,5 | 30,6 | 4,7 | 32,8 | 4,7 | 0,0 | 1 215 | 1 000 |
| Services | 78,1 | 24,8 | 25,7 | 11,5 | 33,0 | 14,0 | 7,6 | 1 165 | 1 005 | |
| Total | 42,1 | 18,7 | 26,6 | 5,7 | 33,1 | 6,1 | 7,1 | 1 200 | 1 000 | |
| Diplôme paramédical et social niveau CAP-BEP | 92,5 | ns | 8,0 | ns | 10,4 | ns | 0,0 | ns | 1 330 | |
| Bac général | S | 39,2 | 15,6 | 13,5 | 10,1 | 20,3 | 35,8 | 36,1 | 1 325 | 1 195 |
| ES, L | 66,8 | 18,2 | 17,0 | 12,2 | 29,7 | 33,7 | 30,5 | 1 240 | 1 090 | |
| Total | 58,2 | 16,4 | 16,2 | 10,7 | 26,4 | 36,7 | 32,3 | 1 295 | 1 110 | |
| Bac technologique et professionnel | Production | 13,7 | 9,3 | 10,8 | 3,6 | 16,7 | 20,3 | 15,8 | 1 295 | 1 100 |
| Services | 72,7 | 19,7 | 17,0 | 14,5 | 26,3 | 26,7 | 19,4 | 1 195 | 1 080 | |
| Total | 47,9 | 12,4 | 16,2 | 6,6 | 25,1 | 22,0 | 19,2 | 1 270 | 1 080 | |
| BTS, DUT et équivalent | Production | 19,7 | 8,5 | 11,1 | 2,7 | 9,2 | 65,0 | 64,5 | 1 460 | 1 335 |
| Services | 65,8 | 13,0 | 10,7 | 5,5 | 10,0 | 59,1 | 36,8 | 1 460 | 1 265 | |
| Total | 51,7 | 10,7 | 10,8 | 4,1 | 10,0 | 62,2 | 39,9 | 1 460 | 1 275 | |
| Deug | 60,7 | 17,0 | 12,4 | 13,3 | 19,1 | 52,4 | 48,5 | 1 335 | 1 270 | |
| Diplôme paramédical et social niveau bac + 2 | 86,1 | 4,7 | 2,8 | 6,6 | 10,4 | 97,9 | 97,6 | 1 625 | 1 595 | |
| Licence, licence professionnelle | Sciences exactes et naturelles, production | 43,8 | 10,6 | 6,1 | 5,3 | 11,2 | 79,4 | 85,7 | 1 560 | 1 530 |
| Sciences humaines et sociales, services | 67,9 | 11,7 | 8,1 | 8,3 | 16,4 | 72,5 | 73,7 | 1 460 | 1 410 | |
| Total | 63,8 | 11,6 | 7,9 | 7,5 | 15,8 | 74,4 | 75,1 | 1 500 | 1 430 | |
| Master 1 et 2, doctorat hors santé | Sciences exactes et naturelles, production | 38,1 | 8,0 | 12,7 | 6,8 | 8,2 | 94,1 | 92,0 | 1 975 | 1 810 |
| Sciences humaines et sociales, services | 61,2 | 12,1 | 11,7 | 8,9 | 14,5 | 81,9 | 74,9 | 1 815 | 1 570 | |
| Total | 56,6 | 10,9 | 11,8 | 8,3 | 13,7 | 85,6 | 77,0 | 1 875 | 1 615 | |
| École d’ingénieurs et de commerce | 30,9 | 8,4 | 8,3 | 1,0 | 3,8 | 96,1 | 94,3 | 2 380 | 2 145 | |
| Doctorat de santé | 63,1 | 1,9 | 4,7 | 10,4 | 29,0 | 99,4 | 99,4 | 2 980 | 2 205 | |
- ns : non significatif
- * Voir définitions.
- Champ : jeunes sortis de formation initiale depuis moins de six ans, France métropolitaine.
- Source : Insee, cumul des enquêtes Emploi de 2003 à 2008.
Vers une plus grande égalité des chances en termes d’emploi pour les débutantes et les débutants
Du fait notamment du choix de leur spécialité de formation, les filles ne tirent pas pleinement parti de leur niveau de diplôme sur le marché du travail. À diplôme, spécialité et durée d’insertion identiques, elles ont un risque de chômage supérieur de 7 % à celui des garçons, au cours des cinq premières années de vie active.
Cet écart n’est pas constant dans le temps. En 2003, les jeunes femmes ont eu les mêmes opportunités de trouver un emploi que les jeunes hommes. En 2005, année où les débutants ont eu des difficultés à s’insérer, les jeunes femmes ont été particulièrement défavorisées (+ 14 % de risque de chômage). Au cours des deux années suivantes, le risque d’être au chômage est plus important pour les débutantes, sans que la différence entre les sexes atteigne le niveau de 2005. En 2008, la situation s’équilibre : débutantes et débutants ont les mêmes risques de chômage.
La crise touche plus les hommes que les femmes, notamment chez les débutants
Le taux de chômage des personnes sorties de formation initiale depuis moins de six ans est supérieur à la moyenne. Au premier trimestre 2003, 15 % des jeunes actifs et 16 % des jeunes actives étaient au chômage, contre 8 % des hommes et 10 % des femmes sur l’ensemble des actifs.
Sur la période récente, la forte hausse du niveau de formation des filles favorise leur insertion professionnelle et se combine aux effets de la crise. Les hommes en début de vie active sont les plus touchés par la crise (graphique). Entre les deuxièmes trimestres de 2008 et de 2009, le taux de chômage des hommes a augmenté de 2,1 points parmi l’ensemble des actifs (+ 1,6 points pour les femmes) et de 6,4 points parmi l’ensemble des débutants (+ 4,4 points chez les débutantes). Cette hausse marquée chez les hommes sortant de formation initiale est notamment due à la baisse de l’emploi intérimaire (7 % des emplois des jeunes hommes au deuxième trimestre 2008, contre 5 % au deuxième trimestre 2009). La moindre embauche dans le secteur de la construction, dont la main-d’œuvre est essentiellement masculine, a aussi contribué à la hausse du taux de chômage des hommes.
Depuis le début de l’année 2008, l’écart entre le taux de chômage des jeunes femmes et celui des jeunes hommes s’est donc amplifié : au deuxième trimestre 2009, parmi les actifs, 18 % des femmes ayant récemment fini leurs études sont au chômage, contre 22 % des hommes.
A contrario, parmi les jeunes actifs en emploi, la situation des femmes à temps partiel s’est dégradée relativement aux hommes. Au deuxième trimestre 2009, 12 % des femmes en début de carrière sont à temps partiel et souhaiteraient travailler davantage, contre seulement 3 % des hommes. Cet écart de 9 points est le plus important depuis le premier trimestre 2008.
graphiqueGraphique – Taux de chômage des débutants et de l'ensemble des actifs (corrigé des variations saisonnières)

- * Voir définitions.
- Champ : France métropolitaine.
- Source : Insee, enquêtes Emploi.
Sources
L’enquête Emploi est réalisée en continu en métropole depuis 2003. Son échantillon est partiellement renouvelé chaque trimestre. Les résultats sont exploités annuellement et trimestriellement. 38 000 ménages ordinaires (à l’exception des communautés du type foyers, cités universitaires, hôpitaux, prisons…) répondent chaque trimestre, soit environ 72 000 personnes de 15 ans ou plus.
Jusqu’en 2002, l’enquête était réalisée annuellement au mois de mars. Son échantillon de 75 000 ménages ordinaires était renouvelé par tiers chaque année.
La méthode de l’enquête Emploi diffère dans les départements d’outre-mer (DOM), ce qui explique l’absence de présentation des résultats sur ces territoires dans cette étude.
L’enquête Emploi est la seule source permettant de mesurer le chômage selon la définition du Bureau international du travail (BIT).
Définitions
Le taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) est la proportion de chômeurs au sens du BIT dans la population active totale BIT (actifs ayant un emploi et chômeurs). Un chômeur au sens du BIT est une personne en âge de travailler (conventionnellement 15 ans ou plus), qui n’a pas travaillé au cours de la semaine de référence, est disponible pour travailler dans les deux semaines et a entrepris des démarches effectives de recherche d’emploi ou a trouvé un emploi qui commence dans les trois mois.
Le taux d’activité est le rapport entre le nombre d’actifs (actifs ayant un emploi et chômeurs) et l’ensemble de la population correspondante.
Les sans-diplôme correspondent ici aux non-diplômés et aux titulaires d’un Certificat d’études primaires ou d’un Brevet d’études du premier cycle, nommé aujourd’hui Brevet des collèges.
Le salaire médian correspond au salaire tel que la moitié des actifs ayant un emploi gagne moins et que l’autre moitié gagne plus. Il se différencie du salaire moyen qui est la moyenne de l’ensemble des salaires de la population considérée. Il s’agit du salaire mensuel net redressé statistiquement des non-réponses y compris les primes mensualisées.
Le sous-emploi correspond, dans cette publication, aux personnes qui ont un emploi à temps partiel, qui souhaitent travailler plus d’heures sur une semaine donnée, et qui sont disponibles pour le faire, qu’elles recherchent ou non un emploi.
Le terme de sortie de formation initiale correspond à la première interruption du parcours d’études amorcé à l’école élémentaire.
Pour en savoir plus
« Formation et emploi », Insee Références, édition 2009.
Chevalier F., Mansuy A., « Une photographie du marché du travail en 2008 - Résultats de l’enquête Emploi », Insee Première n° 1272, décembre 2009.
Beffy M., Leprévost E., Martinelli D., « Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2007 - Formation et emploi des jeunes dans les régions françaises », Insee Première n° 1219, janvier 2009.