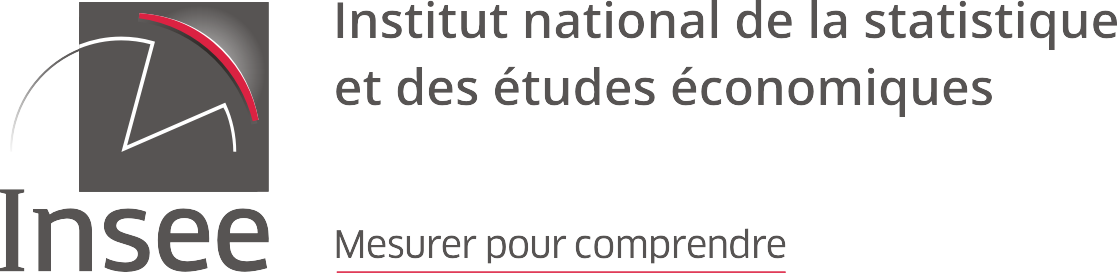Dynamiques de l’emploi dans les communes dotées d’une gare RER : une analyse rétrospective
Dynamiques de l’emploi dans les communes dotées d’une gare RER : une analyse rétrospective
À la différence du futur Grand Paris Express (GPE), le déploiement du Réseau Express Régional (RER) a été conçu, dès les années 1970, pour accompagner des politiques d’aménagement du territoire (création des villes nouvelles, quartier d’affaires de La Défense, zones aéroportuaires). Malgré cela, ces deux réseaux présentent certaines similitudes, de par l’implantation des gares et de la distance qui les sépare. Afin d’apporter un éclairage sur les dynamiques locales de l’emploi que pourrait générer le futur réseau, une analyse rétrospective a été conduite sur les communes dotées d’une gare RER. En 30 ans, si les gains d’emploi en volume se sont répartis de façon relativement équilibrée entre les communes desservies par ce réseau de transport et les autres, les emplois à haute valeur ajoutée ont progressé plus fortement dans la majorité des communes desservies par une gare. Ces constats doivent cependant être nuancés. Ainsi, l’emploi qualifié s’est fortement développé dans les villes nouvelles et les territoires de projet bien après la période de mise en service du RER. Sur la période récente, l’emploi à haute valeur ajoutée a progressé plus fortement dans les communes limitrophes de Paris.
- Un Grand Paris Express en partie comparable au Réseau Express Régional
- Un contexte global de création d’1,3 million d’emplois entre 1968 et 2013 dans l’unité urbaine de Paris
- La tertiarisation de l’économie et la métropolisation en toile de fond des mutations économiques de long terme
- Communes desservies par le RER : un essor lié au déploiement du réseau
- Les emplois de cadres augmentent fortement dans plus de la moitié des communes dotées d’une gare et dans les « nœuds » d’interconnexion
Un Grand Paris Express en partie comparable au Réseau Express Régional
En améliorant les temps d’accès aux différents territoires de l’agglomération parisienne, la mise en service du Grand Paris Express (GPE) est de nature à influer sur les dynamiques et la répartition spatiale des emplois, notamment les plus qualifiés, même en l’absence de toute volonté des pouvoirs publics de développer de nouveaux pôles urbains. De par sa configuration et son implantation, ce nouveau réseau présente en effet des caractéristiques communes avec le Réseau Express Régional (RER), mis en service progressivement entre 1970 et 2004. De ce fait, l’analyse rétrospective de l’évolution des emplois dans les territoires de l’unité urbaine de Paris dotés d’une gare RER (Pour comprendre) renseigne sur la façon dont l’emploi, notamment qualifié, s’est développé et déployé dans les territoires franciliens, pendant et après la mise en service de ce réseau.
Entre 1975 et 1990, période qui couvre les principales mises en service du RER, l’emploi a davantage progressé dans les communes desservies par une gare (hors aéroports et villes nouvelles) que dans celles dotées d’un train de banlieue (Pour en savoir plus). Les stations de RER, en permettant de relier aéroports, villes nouvelles et quartiers d’affaires au cœur de l’agglomération, ont eu un effet positif sur l’implantation des entreprises dans les communes dotées de ces infrastructures. Sur la période, la croissance de l’emploi y a dépassé de 13 % celle des autres communes. Cet effet a pleinement joué dans les communes situées à une distance comprise entre 5 et 20 kilomètres du centre de Paris, en revanche les communes les plus éloignées ont peu tiré profit d’une gare. De la même façon, les gares de RER ont favorisé l’installation de populations plus diplômées et plus aisées dans un premier temps, puis d’emplois qualifiés dans un second temps.
Toutefois, sur un recul historique plus large, ces comparaisons doivent s’apprécier au regard des mutations économiques d’ensemble, peu liées aux réseaux de transports, et ayant affecté les dynamiques de l’emploi. Ainsi, au-delà du déploiement des grands chantiers d’infrastructure au début des années 70, la tertiarisation croissante de l’économie francilienne depuis le début des années 1990, en raison de la libéralisation des échanges européens et mondiaux, a sensiblement modifié la carte et le contenu des emplois dans la région.
Un contexte global de création d’1,3 million d’emplois entre 1968 et 2013 dans l’unité urbaine de Paris
En 2013, l’unité urbaine de Paris compte 5,3 millions d’emplois, soit 1,3 million de plus qu’en 1968. L’emploi a donc progressé de 0,6 % par an en moyenne. Cependant, l’évolution moyenne de longue période résulte de dynamiques différenciées au cours du temps. À l’échelle de l’unité urbaine, l’emploi a stagné au cours des périodes 1975-1982 et 1990-1999.
La distribution spatiale des nouveaux emplois a modifié la géographie de l’emploi au sein de cet espace. En 45 ans, l’emploi s’est desserré du cœur de l’agglomération (figure 1) vers la grande couronne. Ce desserrement s’est principalement opéré entre 1968 et 1999, avec la création des villes nouvelles en Île-de-France (Cergy-Pontoise, Évry-Corbeil, Marne-la-Vallée, Saint-Quentin-en-Yvelines et Sénart) au début des années 70, favorisée par le développement du RER. Ces nouveaux territoires ont attiré des habitants, puis dans un deuxième temps ont contribué à l’émergence de pôles d’emploi en grande couronne grâce notamment à un moindre coût du foncier. La croissance annuelle de l’emploi y a été dynamique : en 45 ans, elle a atteint plus de 5 % et a même dépassé 10 % entre 1982 et 1990, dans certaines communes de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Marne-la-Vallée. L’installation du Technocentre de Renault à Guyancourt en 1998 et l’ouverture du parc d’attractions Eurodisney à Chessy en 1992 ont été notamment des projets très porteurs en matière d’emploi, sans doute facilités par la présence d’une infrastructure autoroutière, mais aussi d'une desserte RER. Les villes nouvelles se sont développées jusqu’au début des années 2000, soit bien au-delà de la mise en service du réseau RER les desservant. Arrivant désormais pour la plupart à maturité, elles sont devenues moins attractives sur le plan économique et l’emploi s’essouffle sur la période récente (2006-2013).
La construction de l’aéroport Roissy Charles De Gaulle a également contribué à dynamiser l’emploi en banlieue parisienne. Cette infrastructure d’envergure internationale a permis la création de nombreux emplois jusqu’au début des années 2010.
Dans une moindre mesure, les communes du Plateau de Saclay (Saclay, Orsay, Gif-sur-Yvette, Palaiseau...) se sont développées sur le plan économique grâce à des politiques d’aménagement du territoire avec l’implantation du CNRS (Centre national de la recherche scientifique) et du CEA (Centre d’études atomiques) après la Seconde Guerre mondiale, puis de grandes écoles (telles que l’École Polytechnique, Supélec et HEC).
À l’inverse, si l’emploi a diminué à Paris en 45 ans, les pertes d’emploi ont surtout été concentrées sur la période 1968-1999. En petite couronne, l’emploi a globalement progressé, mais de façon plus marquée dans certains territoires, tels que le quartier d’affaires de La Défense créé au début des années 60 ou encore Rungis avec l’installation du Marché d’intérêt national en 1969.
La dynamique de desserrement de l’emploi du centre vers la périphérie a connu une inflexion dans les années 2000 sous l’effet d’une métropolisation portée par les politiques d’aménagement du territoire. Depuis lors, la capitale a renoué avec les créations d’emplois, sous l’effet d’un mouvement de redensification des activités économiques qui a également profité aux communes limitrophes (Saint-Denis, Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt) dans lesquelles se sont installées de grandes entreprises du secteur tertiaire.
graphiqueFigure 1 – Un desserrement de l’emploi dans l’agglomération parisienne entre 1968 et 2013Évolution de l'emploi dans les communes de l'unité urbaine de Paris entre 1968 et 2013

- Source : Insee, recensements de la population 1968 et 2013.
La tertiarisation de l’économie et la métropolisation en toile de fond des mutations économiques de long terme
Les cadres des fonctions métropolitaines (CFM) correspondent aux emplois les plus qualifiés et spécifiques aux territoires métropolitains. Observables depuis 1982, leur nombre a plus que doublé en trente ans, passant, au sein de l’unité urbaine de Paris, de un emploi sur dix en 1982 (493 000) à un emploi sur cinq en 2013 (1 146 000).
Avec 650 000 emplois supplémentaires entre 1982 et 2013, ces emplois à haute valeur ajoutée contribuent aux trois quarts des gains d’emploi dans l’unité urbaine. Paris assure le tiers de cette augmentation (+ 200 000 emplois). La croissance de ces emplois est également forte dans les secteurs de La Défense (12 % des gains d’emplois franciliens), à Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux (6 %) et plus récemment à Saint-Denis - Saint-Ouen et Pantin - Bagnolet. Les villes nouvelles, notamment Saint-Quentin-en-Yvelines et Marne-la-Vallée, contribuent, elles aussi, à l’essor des emplois de CFM (figure 2).
graphiqueFigure 2 – Entre 1982 et 2013, l’essor des emplois de cadres des fonctions métropolitaines, plus rapide dans les villes nouvelles, Roissy, La Défense et Issy-les-Moulineaux

- Lecture : à Guyancourt, entre 1982 et 2013, les emplois de CFM ont augmenté au moins quatre fois plus vite que dans l’unité urbaine de Paris.
- Source : Insee, recensements de la population 1982 et 2013.
Communes desservies par le RER : un essor lié au déploiement du réseau
Au sein des 412 communes constituant l’unité urbaine de Paris, 135 sont desservies par au moins une gare RER.
En 2013, ces dernières comptent 3,5 millions d’emplois, soit les deux tiers des emplois de l’unité urbaine. C’est 446 000 emplois de plus qu’en 1982, soit une progression à peine supérieure à celle des communes de l’unité urbaine non desservies par le RER (+ 438 000). Les communes équipées d’une gare RER comptant davantage d’emplois, la progression de l’emploi s’y est révélée moindre en proportion (+ 14,3 % contre + 33,4 %). Leur poids au sein de l’unité urbaine a ainsi fléchi. Elles représentaient 70 % des emplois de l’unité urbaine en 1982, contre 67 % en 1999 et en 2013.
Ces dynamiques sont à nuancer selon les périodes. Entre 1982 et 1990, période qui suit la mise en service du RER, l’emploi progresse davantage dans les communes dotées d’une gare (+ 192 000) que dans les autres (+ 146 000). Cette situation s’explique en raison de l’expansion économique des villes nouvelles et des territoires de projet, à l’œuvre au cours de la période. Entre 1999 et 2013, la différence est encore plus nette : + 392 000 emplois dans les communes équipées d’une gare, + 216 000 emplois dans les autres. Elle correspond au mouvement de redensification des activités économiques observé à Paris et dans les communes de proche banlieue ayant bénéficié du prolongement des lignes de métro existantes. En revanche, en milieu de période (1990-1999), les dynamiques d’emploi sont plus favorables aux communes non équipées d’une gare, principalement en raison des pertes d’emploi enregistrées à Paris.
S’agissant des emplois à haute valeur ajoutée, l’écart entre les communes équipées d’une gare et les autres est encore plus net en volume que pour l’emploi total. Entre 1982 et 2013, l’emploi des CFM a augmenté de 421 000 unités dans les premières, et de 233 000 dans les secondes. Toutefois, à l’instar de l’emploi total, les communes équipées d’une gare étant davantage dotées en emplois, la progression y est plus faible en pourcentage (+ 117 % contre + 174 %). Par conséquent, les communes équipées d’une gare représentent désormais 68 % de l’emploi en CFM de l’unité urbaine, contre près de 73 % en 1982. En outre, les emplois à haute valeur ajoutée ne sont pas surreprésentés dans les communes desservies par le RER : en 2013, les CFM y représentent un peu plus d’un emploi sur cinq, comme dans le reste de l’unité urbaine.
Les emplois de cadres augmentent fortement dans plus de la moitié des communes dotées d’une gare et dans les « nœuds » d’interconnexion
Entre les communes dotées d’une gare et les autres, les dynamiques de l’emploi, notamment qualifié, diffèrent selon les périodes, mais également selon les territoires.
Entre 1982 et 2013, pour près de la moitié des communes desservies par le RER (61 communes, dont Paris), les emplois de cadres ont augmenté à un rythme plus faible que dans l’ensemble de l’unité urbaine. Ces communes sont en général situées en grande couronne ou dans la moitié est de la petite couronne, à plus de 20 km de Paris, et, sans être le terminus de la ligne RER, elles ne sont desservies que par une seule gare. Elles ne constituent en général pas des pôles d’emploi, mais plutôt des communes résidentielles : neuf sur dix ont, en effet, au moins deux fois plus d’habitants que d’emplois. La proportion de cadres résidents quittant ces communes chaque jour pour aller travailler dans des pôles d’emploi est élevée. Au sein de ce groupe de communes, Paris et Versailles font toutefois figure d’exception.
Pour 41 % des communes desservies par une gare RER (soit 55 communes), les emplois de CFM ont progressé jusqu’à deux fois plus que dans l’ensemble de l’unité urbaine. Ce sont, elles aussi, en majorité des communes de grande couronne, situées à plus de 20 km de Paris, traversées par une seule ligne RER, mais elles sont proches des territoires de projet (Roissy, La Défense, Plateau de Saclay, villes nouvelles). Dans ce groupe, figurent également des communes de petite couronne qui correspondent généralement à des territoires en forte croissance depuis 1999 ou encore plus récemment (notamment Saint-Denis, Pantin, Saint-Ouen, Ivry-sur-Seine, Arcueil, Gennevilliers, Meudon).
Enfin, 19 communes desservies par le RER, dont 15 situées en grande couronne, ont connu une très forte progression du nombre d’emplois de CFM entre 1982 et 2013, plus de deux fois supérieure à celle de l’ensemble de l’unité urbaine. Dans ces communes, l’ensemble des emplois a été multiplié par 2,6 entre 1982 et 2013, contre 1,2 dans l’ensemble de l’unité urbaine. Il s’agit principalement de communes appartenant à des territoires de projets tels que les villes nouvelles (Montigny-le-Bretonneux, Noisy-le-Grand, Chessy, Lognes), Roissy (Tremblay-en-France, Villepinte) ou La Défense (Nanterre). Issy-les-Moulineaux, dont le nombre d’emplois de CFM a été multiplié par 10 entre 1982 et 2013, fait également partie de ce groupe.
Au-delà des caractéristiques générales que partagent les communes composant ces différents groupes, l’analyse des disparités territoriales des dynamiques d’emploi des CFM ne permet pas de mettre en évidence l’influence d’autres facteurs tels que la taille ou la densité de population, la distance à Paris ou encore le degré d’accessibilité en transports en commun.
En effet, de par l’interconnexion du réseau de transports au sein de l’unité urbaine parisienne, les gares RER, qui améliorent l’accessibilité aux autres parties du territoire métropolitain, permettent, selon les configurations et les périodes, de développer l’emploi qualifié à proximité, autant que d’accéder à des pôles d’emploi plus éloignés.
Par ailleurs, plusieurs communes d’envergure économique régionale ne disposent pas de gare RER, mais demeurent cependant très accessibles via d’autres transports collectifs lourds (métro, tramway, train de banlieue) ou par une gare RER desservant une commune voisine. C’est le cas notamment de Courbevoie, Roissy-en-France, Boulogne-Billancourt, Levallois-Perret, Montreuil ou encore Guyancourt.
En outre, parallèlement à la mise en service du RER, le développement des grands projets économiques et des villes nouvelles a été accompagné du développement d’axes routiers (A86 et Francilienne), ce qui a permis de diversifier les déplacements domicile-travail et de favoriser le desserrement de la population et des emplois au sein de l’unité urbaine.
Pour comprendre
Pourquoi comparer le Grand Paris Express (GPE) et le Réseau Express Régional (RER) ?
Le Grand Paris Express (GPE) est un projet de métro automatique qui va transformer la desserte et l’accessibilité de la métropole du Grand Paris à l’horizon 2030. Il prévoit la création de 68 nouvelles gares, réparties entre quatre nouvelles lignes (15, 16, 17 et 18) et le prolongement de la ligne 14 (cf. Ouvrir dans un nouvel ongletSocieté du Grand Paris).
Le Réseau Express Régional d’Île-de-France (RER) est un réseau ferré qui a été mis en service progressivement entre 1969 et 2004. Il comprend 5 lignes (A, B, C, D et E), qui s’étendent sur plus de 600 km et desservent près de 450 stations en Île-de-France, dont plus d’une vingtaine souterraines à Paris intra-muros. Ce réseau s’appuie largement sur celui, préexistant, de lignes de trains de banlieue, dont il tente d’améliorer les lacunes : des tunnels dans Paris pour éviter les gares parisiennes en cul-de-sac, et quelques branches supplémentaires vers les villes nouvelles et les aéroports parisiens.
Afin d’estimer a priori les effets du GPE sur l’emploi dans les territoires des futures gares, on procède dans cette étude à une analyse rétrospective de l’évolution des emplois dans les territoires dotés d’une gare RER, car il s’agit du réseau de transport francilien qui présente le plus de similitudes avec le futur GPE, du point de vue de la localisation des gares (essentiellement dans l’unité urbaine de Paris) et de la distance moyenne entre les gares.
Sources
Recensements de la population de 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2008 et 2013.
Définitions
Quinze « fonctions d’emploi » ont été définies par l’Insee à partir des catégories socioprofessionnelles des actifs mentionnées dans les recensements de la population depuis 1982. Elles sont transversales aux secteurs d’activité des entreprises, au statut des travailleurs (indépendant ou salarié, public ou privé) ainsi qu’à leur niveau de qualification (cf. Analyse fonctionnelle des emplois et cadres des fonctions métropolitaines). Cinq de ces fonctions, parce qu’elles sont plus spécifiquement localisées dans les grandes aires urbaines, sont qualifiées de « fonctions métropolitaines » : conception-recherche, commerce interentreprises, culture-loisirs, gestion, prestations intellectuelles.
Le concept de « cadres des fonctions métropolitaines » (CFM) vise à offrir une notion proche des « emplois stratégiques », qui permettent de cerner le rayonnement ou l’attractivité d’un territoire. Les CFM sont définis comme les cadres et les chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus présents dans les cinq fonctions métropolitaines.
La notion d’unité urbaine repose sur la continuité du bâti et le nombre d’habitants. On appelle unité urbaine une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants.
Pour en savoir plus
Couleaud N., Drieux S., « Après 30 ans de desserrement, depuis 1999 l’emploi se densifie à nouveau en petite couronne alors que la population se stabilise », Insee Analyses Île-de-France n° 71, octobre 2017.
Mayer T., Trevien C., « Comment les transports publics modifient-ils le développement des villes ? L’exemple du réseau express régional d’Île-de-France », Insee Analyses n° 25, mai 2016.
Garcia-Lopez M.-A., Hémet C., Viladecans-Marsal E., « Ouvrir dans un nouvel ongletHow does transportation shape intrametropolitan growth ? An answer from the Regional Express Rail », Institut d'Economia de Barcelona, 2015.