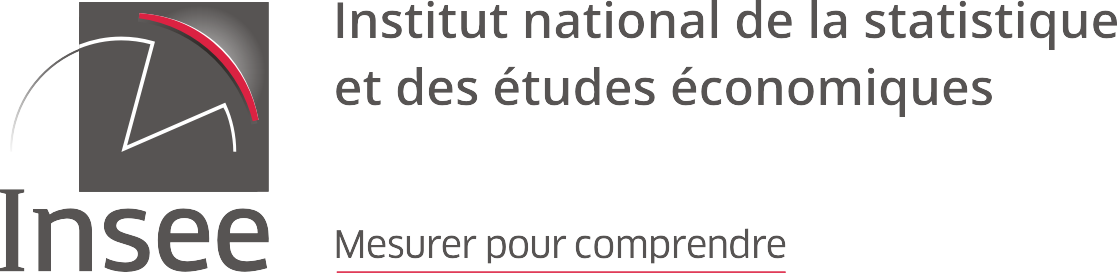Déménager du coeur des grandes agglomérations pour habiter autrement
Déménager du coeur des grandes agglomérations pour habiter autrement
Entre 2013 et 2014, les très grandes aires urbaines d’Auvergne-Rhône-Alpes gagnent, dans leur ensemble, des habitants au jeu des migrations résidentielles. Ces mouvements modifient la répartition de la population entre les différents espaces de ces aires. Elles attirent autant de personnes habitant déjà en Auvergne-Rhône-Alpes que de personnes en provenance d’autres régions. Les déménagements bénéficient principalement aux banlieues et couronnes de ces très grandes aires urbaines et se font au détriment de leurs villes-centres. Toutefois, celles-ci constituent un pivot dans les migrations, territoire préférentiel des échanges, à l’arrivée comme au départ. Les étudiants et les cadres sont nombreux à venir s’y installer. Le désir de devenir propriétaire encourage les jeunes ménages à déménager en banlieue et en couronne, où le prix du foncier est moindre. Ces familles privilégient souvent une installation en maison pour un habitat plus spacieux. Cela est d’autant plus fréquent quand la famille s’agrandit.
- Les villes-centres perdent des habitants au jeu des migrations résidentielles
- Les très grandes aires urbaines attractives vis-à-vis des autres régions
- Les villes-centres, pivots des échanges migratoires
- Quitter la ville-centre...
- … et s’installer en couronne pour devenir propriétaire de sa maison
- … quand la famille s’agrandit ou pour un logement plus grand
- Les migrations résidentielles se concentrent dans les grandes aires urbaines de plus de 100 000 habitants
Entre 2013 et 2014, 11 % de la population de France métropolitaine a déménagé. Ces migrations résidentielles, inter ou intra-régionales, modifient la répartition de la population dans les différents types d’espace du territoire, notamment au sein des grandes aires urbaines (définitions). En Auvergne-Rhône-Alpes, les grandes aires urbaines de plus de 100 000 habitants, qui concentrent 5,2 millions d’habitants soit 63 % de la population régionale, jouent un rôle majeur dans les migrations résidentielles (encadré). Entre 2013 et 2014, l’excédent des arrivées sur les départs leur a permis un gain modéré de 1,7 habitant pour 1 000 présents. Cela les place derrière celles des régions de la façade atlantique, très attractives sur le plan migratoire.
Les villes-centres perdent des habitants au jeu des migrations résidentielles
La population des trois plus grandes aires urbaines de la région, Lyon, Grenoble et Saint-Étienne, reste stable au jeu des migrations résidentielles. En effet, les arrivées et les départs nombreux se compensent dans ces espaces métropolitains (figure 1). Malgré sa taille plus modeste, l’aire urbaine de Valence est dans la même situation d’équilibre. En revanche, celle de Clermont-Ferrand est la seule métropole qui gagne des habitants sous l’effet des migrations (+ 6 ‰), car elle structure l’ouest régional en captant la plupart des flux migratoires. Les aires urbaines du sillon alpin, Chambéry et Annecy, gagnent elles aussi de la population (+ 7 ‰). Annecy bénéficie de l’étalement urbain du Genevois français où l’offre de logements est en tension. Le réseau d’infrastructures et de transport développé autour de Grenoble y contribue également. Bourg-en-Bresse profite du développement de la périphérie de Lyon et gagne des habitants (+ 6 ‰). En revanche, Roanne et Vienne, moins peuplées, en perdent (respectivement – 4 ‰ et – 6 ‰), en lien avec le déclin de l’emploi.
tableauFigure 1 – Les villes-centres perdent des habitants à l’issue des migrations résidentiellesImpact des migrations résidentielles sur la population des très grandes aires urbaines, par type d'espace (en %)
| GAU | Ville-centre | Banlieue | Couronne | Ensemble de l’aire urbaine |
|---|---|---|---|---|
| Lyon | -0,93 | 0,19 | 0,41 | 0,00 |
| Grenoble | -1,82 | 0,56 | 0,42 | -0,04 |
| Saint-Étienne | -0,81 | 0,16 | 0,70 | -0,01 |
| Clermont-Ferrand | -0,03 | 0,65 | 0,94 | 0,58 |
| Annecy | -1,78 | 1,36 | 1,52 | 0,66 |
| Chambéry | -0,53 | 1,90 | 0,47 | 0,68 |
| Valence | -1,75 | 1,58 | 0,24 | 0,03 |
| Bourg-en-Bresse | -0,29 | 1,41 | 0,92 | 0,60 |
| Vienne | -1,57 | -0,18 | -0,63 | -0,62 |
| Roanne | -1,87 | 0,45 | 0,28 | -0,36 |
- Note de Lecture : entre 2013 et 2014, les migrations résidentielles ont eu un impact positif de + 0,7 % sur la population de l’aire urbaine d’Annecy. En distinguant les espaces de l‘aire urbaine et en intégrant les échanges internes, la ville-centre d’Annecy a perdu 1,8 % de sa population Alors que la population de sa banlieue et sa couronne ont augmenté respectivement de + 1,4 % et + 1,5 % durant cette même période.
- Champ : migrations résidentielles (y compris échanges internes) des dix grandes aires de plus de 100 000 habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes (hors Genève Annemasse), entre 2013 et 2014.
- Source : Insee, Recensement de la population 2014
graphiqueFigure 1 – Les villes-centres perdent des habitants à l’issue des migrations résidentiellesImpact des migrations résidentielles sur la population des très grandes aires urbaines, par type d'espace (en %)

- Note de Lecture : entre 2013 et 2014, les migrations résidentielles ont eu un impact positif de + 0,7 % sur la population de l’aire urbaine d’Annecy. En distinguant les espaces de l‘aire urbaine et en intégrant les échanges internes, la ville-centre d’Annecy a perdu 1,8 % de sa population Alors que la population de sa banlieue et sa couronne ont augmenté respectivement de + 1,4 % et + 1,5 % durant cette même période.
- Champ : migrations résidentielles (y compris échanges internes) des dix grandes aires de plus de 100 000 habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes (hors Genève Annemasse), entre 2013 et 2014.
- Source : Insee, Recensement de la population 2014
Les très grandes aires urbaines se composent d’une ville-centre, d’une banlieue et d’une couronne (définitions), espaces pour lesquels l’impact des migrations résidentielles n’est pas le même, en particulier pour les villes-centres. En effet, outre les arrivées et les départs, d’autres migrations résidentielles ont lieu au sein même des aires urbaines, entre les différents espaces qui les composent. À l’issue de l’ensemble de ces mobilités, toutes les villes-centres de la région perdent des habitants, au profit de leurs banlieue et couronne. Seule la ville-centre de Clermont-Ferrand fait exception et reste à l’équilibre.
Toutefois, les très grandes aires urbaines de la région restent moteur de la croissance démographique d’Auvergne-Rhône-Alpes. Le déficit migratoire de ces aires, et notamment celui de leurs villes-centres, est à relativiser car aux migrations résidentielles doivent s’ajouter le bilan des échanges avec l’étranger et le solde naturel toujours positif (excédent des naissances sur les décès), qui conduisent in fine à des gains de population.
Les très grandes aires urbaines attractives vis-à-vis des autres régions
Entre 2013 et 2014, 154 000 nouveaux résidents se sont installés dans les très grandes aires de la région. La moitié d’entre eux habitaient déjà en Auvergne-Rhône-Alpes, les autres provenant d’Île-de-France (11 % des arrivées totales), en lien avec son poids démographique, puis de Provence-Alpes-Côte d’Azur (7 %), de par sa proximité géographique (figure 2). Seules les aires de Lyon et de Clermont-Ferrand, préfecture et ex-préfecture de région, comptent plus d’arrivées inter-régionales que d’arrivées intra-régionales. Ainsi, 62 % des arrivants dans l’aire urbaine de Lyon et 53 % des arrivants dans celle de Clermont-Ferrand proviennent d’une autre région.
tableauFigure 2 – Des migrations résidentielles de proximitéRépartition des arrivants dans les très grandes aires urbaines entre 2013 et 2014 selon leur région antérieure (en %)
| Auvergne-Rhône-Alpes | Île-de-France | Régions limitrophes | Autres régions | |
|---|---|---|---|---|
| Lyon | 38,0 | 15,3 | 28,8 | 17,9 |
| Clermont-Ferrand | 47,3 | 9,8 | 30,8 | 12,0 |
| Grenoble | 51,9 | 11,2 | 24,4 | 12,5 |
| Annecy | 60,9 | 9,6 | 15,9 | 13,6 |
| Bourg-en-Bresse | 63,5 | 4,5 | 22,2 | 9,9 |
| Valence | 64,0 | 4,6 | 22,6 | 8,8 |
| Chambéry | 64,5 | 8,2 | 14,8 | 12,5 |
| Saint-Étienne | 64,8 | 6,1 | 19,6 | 9,5 |
| Roanne | 65,9 | 6,5 | 19,7 | 7,9 |
| Vienne | 74,3 | 4,1 | 14,2 | 7,5 |
| Ensemble | 50,1 | 11,2 | 24,8 | 13,9 |
- Note de lecture : pour l’ensemble des dix très grandes aires urbaines, 50 % des arrivants viennent de la région et 11 % viennent d’Île-de-France.
- Champ : les dix grandes aires urbaines de plus de 100 000 habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes (hors Genève-Annemasse).
- Source : Insee, Recensement de la population 2014
graphiqueFigure 2 – Des migrations résidentielles de proximitéRépartition des arrivants dans les très grandes aires urbaines entre 2013 et 2014 selon leur région antérieure (en %)

- Note de lecture : pour l’ensemble des dix très grandes aires urbaines, 50 % des arrivants viennent de la région et 11 % viennent d’Île-de-France.
- Champ : les dix grandes aires urbaines de plus de 100 000 habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes (hors Genève-Annemasse).
- Source : Insee, Recensement de la population 2014
Les très grandes aires de la région sont attractives au regard des autres régions. Le solde des arrivées et des départs est de + 10 100 habitants. Ces arrivants proviennent souvent d’une région voisine. Ainsi, l’aire urbaine de Bourg-en-Bresse attire davantage des habitants de Bourgogne-Franche-Comté (11 % de ses arrivées contre 6 % en moyenne sur l’ensemble des très grandes aires). De la même manière, l’aire urbaine de Clermont-Ferrand attire les habitants de Nouvelle-Aquitaine (8 % des arrivées contre 4 % en moyenne).
Parmi les nouveaux résidents provenant de la région, plus de la moitié habitaient déjà une autre très grande aire urbaine. Toutefois, le solde des migrations résidentielles avec le reste de la région est négatif. En effet, 36 700 habitants de la région qui n’habitaient pas une très grande aire urbaine sont venus s’y installer, alors que 38 700 ont fait le chemin inverse. Ce déficit est en partie lié à l’étalement des très grandes aires urbaines, dont la population s’installe au-delà de leurs limites actuellement définies.
Les villes-centres, pivots des échanges migratoires
En provenance d’une autre région ou du reste d’Auvergne-Rhône-Alpes, 53 % des arrivants dans les très grandes aires privilégient une installation dans les villes-centres, qui rassemblent les services et divertissements, les emplois et les universités. Ces espaces sont particulièrement attractifs pour les jeunes de 15 à 24 ans, souvent étudiants et parmi les plus mobiles, ainsi que pour les cadres, dont l’emploi se concentre dans les grands pôles urbains. Dès lors, les jeunes représentent plus de la moitié des arrivants dans les villes-centres des grandes agglomérations universitaires. Parmi les actifs, trois sur dix sont des cadres.
De ce fait, le taux d’entrée dans les villes-centres est plus fort que dans les banlieues et couronnes. Les arrivées en provenance de ces deux derniers espaces amplifient le phénomène. En parallèle de leur attraction résidentielle, les villes-centres sont de véritables pivots des échanges migratoires, car elles diffusent aussi leur population, notamment à courte distance vers la banlieue et la couronne (figure 3). Ainsi, plus de la moitié des départs des très grandes aires le sont depuis les villes-centres.
tableauFigure 3 – Partir de la ville-centre pour s’installer en banlieueRépartition des sortants des villes-centres entre 2013 et 2014, selon l’espace d’installation (en %)
| Banlieue | Couronne | Reste Auvergne-Rhône-Alpes | Hors Auvergne-Rhône-Alpes | |
|---|---|---|---|---|
| Chambéry | 45 | 5 | 25 | 25 |
| Lyon | 36 | 7 | 18 | 40 |
| Grenoble | 35 | 7 | 25 | 33 |
| Annecy | 34 | 10 | 33 | 24 |
| Roanne | 30 | 10 | 39 | 21 |
| Saint-Étienne | 25 | 15 | 37 | 23 |
| Valence | 25 | 10 | 42 | 24 |
| Clermont-Ferrand | 23 | 19 | 25 | 34 |
| Vienne | 22 | 7 | 50 | 21 |
| Bourg-en-Bresse | 18 | 26 | 32 | 24 |
| Ensemble | 32 | 10 | 26 | 32 |
- Note de lecture : pour l’ensemble des grandes aires urbaines 32 % des sortants de ville-centre ont déménagé en banlieue et 10 % en couronne.
- Champ : les dix grandes aires urbaines de plus de 100 000 habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes (hors Genève-Annemasse).
- Source : Insee, Recensement de la population 2014
graphiqueFigure 3 – Partir de la ville-centre pour s’installer en banlieueRépartition des sortants des villes-centres entre 2013 et 2014, selon l’espace d’installation (en %)

- Note de lecture : pour l’ensemble des grandes aires urbaines 32 % des sortants de ville-centre ont déménagé en banlieue et 10 % en couronne.
- Champ : les dix grandes aires urbaines de plus de 100 000 habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes (hors Genève-Annemasse).
- Source : Insee, Recensement de la population 2014
Les habitants quittant les villes-centres (vers la banlieue, la couronne ou au-delà) s’installent à 32 % en banlieue et à 10 % en couronne. La part des migrations de la ville-centre vers la banlieue ou la couronne varie néanmoins très fortement selon l’aire urbaine. Chambéry présente une part plus importante de migrations vers la banlieue (45 %) tandis qu’à Bourg-en-Bresse, la proportion de migrations vers la couronne (26 %) est plus marquée que vers sa banlieue. Ces différences sont le reflet de la morphologie de ces aires et de la répartition de leur population entre les espaces. En effet, le poids démographique de la couronne de l’aire urbaine de Chambéry est faible (16 % des habitants de l’aire contre 29 % en moyenne pour les autres très grandes aires). Inversement, la banlieue de Bourg-en-Bresse est peu peuplée (15 % des habitants de l’aire contre 45 % en moyenne). La géographie de l’aire de Vienne, positionnée sur quatre départements, explique que la moitié des habitants quittant la ville-centre, entourée de collines, migrent vers un autre département d’Auvergne-Rhône-Alpes alors que ce n’est qu’un quart pour les autres très grandes aires.
Quitter la ville-centre...
Entre 2013 et 2014, 457 000 habitants de la région ont déménagé tout en restant dans leur très grande aire urbaine, soit 8,7 % de la population de ces aires. Ce taux de mobilité résidentielle interne est plus fort dans les aires les plus peuplées. Il avoisine les 9 % dans les métropoles de Lyon, Clermont-Ferrand et Grenoble, contre 6 % pour Vienne. Les trois quarts des habitants n’ont pas changé d’espace (ville-centre, banlieue ou couronne) et près de la moitié de la population est même restée dans sa commune.
Un quart des habitants ont donc changé d’espace de résidence. Parmi eux, les déménagements des villes-centres vers la banlieue sont les plus nombreux. Ils représentent en moyenne 30 % de ces migrations résidentielles. Celles vers la couronne s’élèvent à 9 %.
Entre ville-centre, banlieue et couronne, les déménagements sont toujours plus nombreux dans le sens de l’éloignement vis-à-vis du centre (six déménagements sur dix) que dans le sens inverse. Ces mouvements reflètent le phénomène de desserrement et de périurbanisation qui touche toutes les villes françaises.
Par ailleurs, le nombre de déménagements est plus élevé dans les villes-centres. Ces dernières accueillent une population plus densément répartie, plus jeune et aussi plus mobile. Les locataires, majoritaires dans les villes-centres, sont plus enclins à changer de logement que les propriétaires. Ainsi, 12 % des habitants de ville-centre ont changé de logement tout en restant dans l’aire urbaine alors que cette part est de 8 % en banlieue et de 7 % en couronne.
… et s’installer en couronne pour devenir propriétaire de sa maison
L’observation des changements survenant au moment de la mobilité résidentielle permet d’identifier d’autres motifs de déménagement (figure 4) que ceux liés aux parcours de formations ou à l’emploi. Quelle que soit l’aire urbaine de la région, ces motifs de déménagements restent similaires. Leur compréhension constitue aussi un enjeu en matière d’aménagement du territoire et d’accompagnement des populations.
tableauFigure 4 – Accéder à la propriété et vivre dans un logement individuelRépartition des sortants des villes-centres en 2014, selon la situation avant et après la migration (%)
| Banlieue | Couronne | Reste Auvergne-Rhône-Alpes | Hors Auvergne-Rhône-Alpes | |
|---|---|---|---|---|
| Accès à un logement individuel | 26 | 65 | 40 | 33 |
| Maintien d’un logement individuel | 41 | 72 | 38 | 33 |
| Accès à la propriété | 32 | 49 | 39 | 31 |
| Maintien dans le statut de propriétaire | 49 | 59 | 38 | 27 |
| Maintien dans le statut de locataire | 61 | 42 | 54 | 61 |
| Ménage de taille croissante | 28,29 | 35,94 | 41,31 | 36,37 |
| Ménage de taille constante | 50,75 | 48,25 | 39,63 | 41,2 |
| Ménage de taille décroissante | 20,95 | 15,81 | 19,06 | 22,43 |
| Taille de logement croissante | 38,98 | 49,72 | 46 | 39,45 |
| Taille de logement constante | 21,87 | 18,24 | 21,45 | 22,59 |
| Taille de logement décroissante | 18,57 | 13,17 | 16,45 | 19,37 |
- Note de lecture : lorsqu’ils quittent la ville-centre pour s’installer en couronne, 65 % des habitants initialement en appartement accèdent À un logement individuel et 49 % des locataires deviennent propriétaires.
- Champ : les dix grandes aires urbaines de plus de 100 000 habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes (hors Genève-Annemasse).
- Source : Insee, Fideli 2014
graphiqueFigure 4 – Accéder à la propriété et vivre dans un logement individuelRépartition des sortants des villes-centres en 2014, selon la situation avant et après la migration (%)

- Note de lecture : lorsqu’ils quittent la ville-centre pour s’installer en couronne, 65 % des habitants initialement en appartement accèdent À un logement individuel et 49 % des locataires deviennent propriétaires.
- Champ : les dix grandes aires urbaines de plus de 100 000 habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes (hors Genève-Annemasse).
- Source : Insee, Fideli 2014
Vouloir accéder à la propriété nécessite souvent de s’éloigner vers la périphérie des aires. Si les locataires quittant la ville-centre et s’installant en banlieue sont un tiers à acquérir leur logement, c’est le cas de la moitié de ceux qui déménagent pour la couronne, où le prix du foncier est souvent moins élevé. Les nouveaux propriétaires dans les couronnes sont par ailleurs, plus nombreux parmi ceux s’y installant que parmi ceux qui y résidaient déjà. Quatre locataires sur dix arrivant dans les couronnes des très grandes aires de la région, quelle que soit leur provenance, y deviennent propriétaires alors que ceux qui habitaient déjà sur place sont trois sur dix à le devenir après déménagement. Toutefois, le taux d’accession des habitants des couronnes est limité par le fait que 73 % d’entre eux sont déjà propriétaires.
L’opportunité d’h abiter une maison est le motif principal de mobilité lorsqu’on change de type de logement au départ des villes-centres. Parmi les résidents vivant en appartement et quittant la ville-centre, 36 % d’entre eux déménagent ainsi pour être dans une maison. Passer d’un appartement à l’habitat individuel pousse encore à s’installer en couronne où l’accès à une maison représente 56 % des déménagements des habitants entrant en couronne (quelle que soit leur provenance). En effet, moins d’un logement sur dix est une maison en ville-centre contre huit sur dix en couronne.
Devenir propriétaire d’une maison est ainsi le changement de situation le plus fréquent lors d’un déménagement au départ de la ville-centre (près de deux sur dix en moyenne et trois sur dix pour les migrations vers la couronne). Néanmoins, trois habitants sur dix restent locataires d’un appartement après un déménagement depuis la ville-centre.
… quand la famille s’agrandit ou pour un logement plus grand
Les migrations résidentielles vers la périphérie sont souvent liées au désir ou à la nécessité d’avoir un logement plus grand, alors que les retours dans la ville-centre s’accompagnent plutôt d’une diminution de la taille du logement. Quatre habitants quittant la ville-centre sur dix déménagent pour un logement plus grand et privilégient davantage une installation en couronne plutôt qu’en banlieue. Ainsi, la moitié des migrations de ville-centre vers couronne s’accompagnent d’une augmentation de la taille du logement contre 39 % vers la banlieue. Pour les habitants quittant la banlieue et s’installant en couronne, quatre déménagements sur dix concernent également un logement plus grand. À l’inverse, quatre fois sur dix les migrations de la banlieue vers la ville-centre se font pour un logement plus petit. Ces déménagements vers la couronne concernent pour près de la moitié des personnes âgées de 25 à 39 ans, le plus souvent des familles avec enfants. A contrario, 36 % des personnes allant de la couronne à la ville-centre sont des étudiants, s’installant dans un logement plus petit.
L’adaptation de la taille du logement est souvent associée à celle du ménage (mise en couple, arrivée ou départ des enfants, séparation, etc.). Plus d’un départ des villes-centres sur deux s’accompagne d’un changement de la taille du ménage, dont près des deux tiers constituent une augmentation. Ainsi, un habitant sur cinq qui quitte une ville-centre déménage quand la famille s’agrandit et pour un logement plus grand.Cela est particulièrement marqué dans les métropoles de la région, notamment celle de Grenoble (25 %). À l’inverse, près d’un quart des habitants arrivant dans une ville-centre s’installent dans un logement plus petit à l’occasion d’une diminution de la taille du ménage. Ceci peut refléter les phénomènes de décohabitation, surtout dans les métropoles.
Au départ des villes-centres, l’augmentation de la taille du ménage ou de celle du logement peut aussi conduire à s’éloigner au-delà de l’aire urbaine, tout en restant dans la région. Ainsi, parmi les sortants de villes-centres qui réalisent ce type de mouvements, 41 % ont un ménage plus grand contre 35 % en moyenne. Toutefois, au départ des couronnes, la variation de la taille du logement n’est plus un motif prédominant de mobilité vers l’extérieur de l’aire urbaine.
Les migrations résidentielles se concentrent dans les grandes aires urbaines de plus de 100 000 habitants
Entre 2013 et 2014, 121 200 habitants sont arrivés en Auvergne-Rhône-Alpes en provenance d’une autre région et 104 100 en sont partis pour une autre. Ainsi, 17 100 résidents supplémentaires se sont installés dans la région.
Les échanges migratoires avec les autres régions françaises se soldent par un gain de population dans l’ensemble des espaces d’Auvergne-Rhône-Alpes, qu’ils soient urbains, périurbains ou plus éloignés des villes, à l’exception des villes-centres des grandes aires urbaines de plus de 100 000 habitants. Leurs banlieues accueillent la moitié des habitants supplémentaires. Les autres nouveaux habitants privilégient à 12 % une installation dans leurs couronnes.
La situation des villes-centres de ces très grandes aires est particulière puisque, sur l’ensemble des migrations observées, 39 % des arrivées et 35 % des départs concernent des échanges inter-régionaux, largement plus que les autres espaces du zonage en aire urbaine.
Entre 2013 et 2014, 779 000 habitants de la région ont également déménagé au sein de la région, soit 10 % de la population. Près de 4 habitants sur 10 ont modifié leur espace de résidence. La moitié d’entre eux changent de résidence uniquement au sein des grandes aires urbaines de plus de 100 000 habitants.
Ainsi, à l’issue de ces mouvements, les villes-centres des grandes aires de plus de 100 000 habitants perdent 13 200 habitants, tandis que leurs banlieues et couronnes en gagnent respectivement 10 800 et 11 000. Ces mouvements sont le reflet d’une périurbanisation qui concerne les principales villes françaises.
Définitions
Une grande aire urbaine est un ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des communes dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.
Les grandes aires urbaines se décomposent en ville-centre, banlieue et couronne. Si une commune représente plus de 50 % de la population de l’unité urbaine, elle est ville-centre. Les communes urbaines qui ne sont pas villes-centres constituent la banlieue. La couronne recouvre l’ensemble des communes de l’aire urbaine à l’exclusion de l’unité urbaine.
Cette étude porte sur les dix aires urbaines de plus de 100 000 habitants de la région, hormis celle de Genève-Annemasse, car les sources utilisées ne permettent pas de prendre en compte les migrations avec l’étranger.
Dans cette étude, les migrations résidentielles sont étudiées à partir de deux sources différentes.
• Le recensement de la population 2014 permet de dénombrer les personnes ayant changé de territoire de résidence au cours de l’année 2013, à l’aide d’une question permettant de savoir où vivait la personne un an auparavant.
• Les fichiers démographiques sur les logements et les individus (Fideli 2014) permettent de caractériser ces mobilités à partir de données issues de sources fiscales, grâce à l’analyse des caractéristiques du ménage d’appartenance ou du logement, avant et après la migration. Les analyses portent sur l’ensemble des migrations qui ont eu lieu entre 2013 et 2014.
Pour en savoir plus
• « Échanges migratoires : des arrivées d’étudiants et de travailleurs qualifiés », Insee Dossier Auvergne-Rhône-Alpes n° 4, octobre 2018
• « Déménagements au sein de la région : des mobilités nombreuses au sein des espaces urbains », Insee Dossier Auvergne-Rhône-Alpes n° 4, octobre 2018
• « Attractivité démographique : un enjeu pour les territoires en difficulté », Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes n° 43, juillet 2017