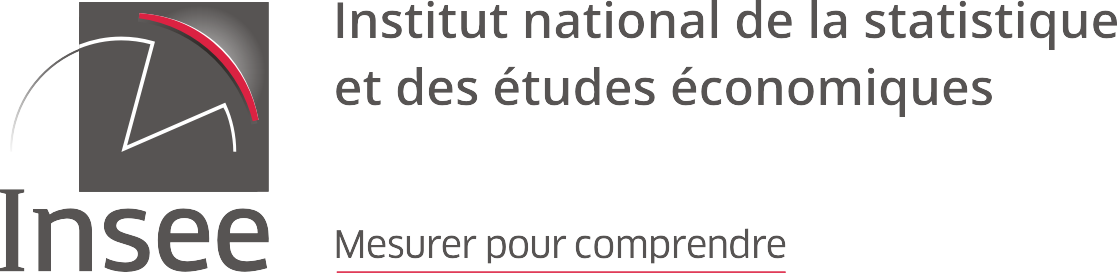Le système métropolitain toulousain vu à travers les migrations et les parcours résidentiels
Le système métropolitain toulousain vu à travers les migrations et les parcours résidentiels
La forte attractivité qui caractérise le système métropolitain toulousain constitue un enjeu de politique publique fort. Trois approches complémentaires permettent d’analyser les échanges entre ce système et les autres territoires ainsi que les migrations internes à cet ensemble. Basées sur l’étude des flux de déménagements, des profils des nouveaux arrivants et de l’articulation des parcours résidentiels avec les différentes étapes de la vie, elles permettent de mieux connaître les nouveaux arrivants et ainsi d’adapter au mieux l’offre de logements et de services nécessaires pour les accueillir.
L’aire urbaine de Toulouse est la quatrième de France par sa population (1,35 million d’habitants en 2016). Elle génère et polarise de nombreux flux économiques et démographiques au sein d’un réseau qu’elle constitue avec 17 villes moyennes disposées en étoile autour d’elle. De Tarbes à Rodez, d’Agen à Carcassonne, ce système métropolitain, constitué uniquement de l’aire urbaine de Toulouse et des aires urbaines de ces villes moyennes, rassemble 2,3 millions d’habitants (figure 1). Il se distingue des autres systèmes, tels ceux de Bordeaux, Nantes, Rennes ou Lyon, par un fort monocentrisme, avec la prépondérance de l’aire urbaine toulousaine, 12 fois plus peuplée que la deuxième aire du système (Tarbes).
graphiqueFigure 1 – Le système métropolitain toulousain

- Sources : Insee ; aua/T
Un espace de coopérations
La réalité de ce système est confortée par deux cadres de réflexion et d’action politique : « l’interscot Grand Bassin Toulousain » et « le Dialogue métropolitain ». Le premier est une démarche volontaire d’échanges et de coopérations entre les territoires situés dans un rayon d’une heure environ de l’agglomération toulousaine. D’abord mis en place à l’échelle de l’aire urbaine toulousaine à partir de 2001 puis du Grand Bassin Toulousain (GBT) depuis 2017, l’interscot rassemble 12 syndicats de SCoT (Schéma de cohérence territoriale) et a pour objet de faciliter la coordination et d’articuler les enjeux d’aménagement. Le Dialogue métropolitain est, quant à lui, porté par une association constituée en 2013 qui réunit 11 intercommunalités. Il repose sur la volonté de ses membres de mener une réflexion commune et globale sur le territoire métropolitain toulousain, pour mieux répondre aux défis urbains inhérents à sa croissance démographique et à sa forte attractivité.
Ces démarches ont pour objectif de faire dialoguer et coopérer des intercommunalités de tailles très différentes. Celles-ci sont confrontées à des enjeux métropolitains, urbains, périurbains et ruraux en matière d’aménagement et de cohésion des territoires. Ces démarches font figure d’exemples et sont suivies à l’échelle nationale par de nombreux acteurs publics.
L’attractivité, un enjeu de cohésion pour les territoires
Au cours de l’année 2014, 74 700 personnes s’installent dans l’une des 18 aires du système métropolitain toulousain, qu’elles viennent d’Occitanie, de territoires proches, ou d’autres régions. Inversement, 65 700 personnes en partent. Le système toulousain gagne ainsi 9 000 habitants par le jeu des déménagements. Ce territoire est ainsi particulièrement attractif, mais pas davantage que les autres systèmes métropolitains dynamiques de l’ouest du pays.
Prégnante depuis de nombreuses années, la question de l’attractivité de cet ensemble est d’autant plus d’actualité que la plupart des syndicats de SCoT entendent « revisiter » d’ici 2020 leur projet de territoire et les projets d’aménagement reposant sur des projections démographiques nouvelles. L’enjeu est d’adapter l’offre de logements et de services aux besoins consécutifs à ces arrivées nombreuses de populations, dont le profil n’est pas forcément le même que celui de la population déjà présente. Au sein du système, les différences d’une aire urbaine à l’autre sont des indicateurs indispensables pour mener toute politique visant à une certaine cohérence territoriale.
Toulouse capte davantage les provenances lointaines
L’aire urbaine de Toulouse ne capte que 55 % des nouveaux arrivants dans l’ensemble du système, un peu moins que son poids démographique (58 %). Mais elle polarise davantage les arrivées plus lointaines, en accueillant 63 % des arrivants provenant des territoires les plus éloignés. Cette situation se retrouve notamment dans les autres systèmes métropolitains attractifs de la côte atlantique. La capacité à attirer des populations de l’ensemble du pays est liée à la taille de l’agglomération. En effet, les plus grosses agglomérations proposent une offre de formation dans l’enseignement supérieur qui attire au-delà du cadre de la région et disposent d’un tissu économique qui favorise l’arrivée de cadres, ceux-ci déménageant davantage sur de longues distances.
Les nouveaux habitants des autres aires urbaines du système métropolitain toulousain viennent de plus près. Mais il existe des différences importantes selon les aires urbaines. Pour la plupart d’entre elles, la moitié des nouveaux arrivants viennent de moins de 100 km (par exemple, 55 km pour Castelsarrasin ou Pamiers). Pour seulement quatre d’entre elles (Foix, Figeac, Agen, Tarbes), la distance médiane dépasse les 100 km, tout en restant très en deçà des 260 km observés pour l’aire urbaine de Toulouse.
Les échanges entre les aires urbaines du système autres que Toulouse ne sont pas majoritaires au sein de cet ensemble. Néanmoins, la proximité favorisant les déménagements, ils sont nombreux lorsqu’elles sont proches de Toulouse ou qu’elles fonctionnent en binôme avec une aire urbaine voisine. C’est le cas de Montauban et Castelsarrasin, de Pamiers et Foix, de Mazamet et Castres. Dans ces aires urbaines, entre 28 % et 37 % des nouveaux arrivants vivaient déjà dans l’une des villes du système métropolitain. À l’opposé, dans des villes plus éloignées de Toulouse, la proportion de nouveaux arrivants en provenance du système est nettement plus faible, comme à Millau, Agen, Villeneuve-sur-Lot ou Carcassonne (de 12 % à 17 %).
Éclairer les dynamiques métropolitaines toulousaines
Ces premiers constats et ces questions relatives à l’attractivité résidentielle des 18 aires urbaines du système métropolitain toulousain conduisent à approfondir la réflexion selon des approches complémentaires.
L’analyse des flux migratoires entre les aires du système permet de dresser un premier constat : en dehors des étudiants, les échanges entre Toulouse et les villes moyennes alentour sont nombreux et moins déséquilibrés qu’on ne pourrait l’imaginer. Deuxième constat : le profil des personnes qui déménagent entre Toulouse et chacune des aires urbaines du système métropolitain est différent d’une ville à l’autre, signe de la complexité des facteurs explicatifs de ces échanges.
Compte tenu de la prépondérance de Toulouse au sein de ce système, l’examen du profil des nouveaux arrivants dans cette aire urbaine est indispensable pour préciser l’offre de logements nécessaire à leur accueil. La question de l’impact des migrations sur la structure de la population est aussi posée et quantifiée : grâce aux nombreuses arrivées d’étudiants au fil des ans et depuis longtemps, la population de l’aire urbaine reste jeune.
L’analyse est complétée par une étude spécifique des déménagements au sein de l’aire urbaine de Toulouse, dans ses trois espaces, ville-centre, banlieue et couronne périurbaine. L’approche par les parcours résidentiels, liés aux cycles de vie, permet de mieux percevoir la demande en logements selon l’espace de vie. Ainsi, la moitié des 63 700 déménagements réalisés au sein de l’aire urbaine de Toulouse en 2015 s’accompagnent d’un changement de structure du ménage. Lors d’un rapprochement de la ville-centre, il s’agit souvent de décohabitation (départ d’un enfant, séparation), alors que les ménages qui s’éloignent de la ville-centre s’inscrivent davantage dans une phase de construction inscrite a priori dans la durée (mise en couple, arrivée d’un enfant, accès à la propriété…).
Sources
Les migrations résidentielles, qui s’accompagnent d’un déménagement, sont repérées lors du recensement de la population (question « Où habitiez-vous le 1ᵉʳ janvier [de l’année antérieure] ? »). Le taux de migration est le rapport entre le solde migratoire (différence entre les entrées et les sorties) et la population d’une zone considérée.
Définitions
L’aire urbaine est composée d’un pôle urbain (ou unité urbaine, agglomération continûment bâtie) et de sa zone d’influence en matière d’emploi, la couronne périurbaine.
Le système métropolitain toulousain est constitué de Toulouse et de l’ensemble des villes fonctionnant en réseau autour de la capitale régionale, à l’instar d’autres systèmes centrés autour de nombreuses métropoles (Paris, Lille notamment). Il comprend Toulouse, 15 aires en Occitanie (Albi, Auch, Cahors, Carcassonne, Castelsarrasin, Castres, Figeac, Foix, Mazamet, Millau, Montauban, Pamiers, Rodez, Saint-Gaudens, Tarbes) et 2 en Nouvelle-Aquitaine (Agen et Villeneuve-sur-Lot). Cet ensemble ne comprend pas les espaces interstitiels (espaces ruraux, petites villes et leurs zones d’influence).
Territoires situés à plus d’une heure de route d’un ensemble contigu incluant les 18 aires urbaines du système métropolitain.
Pour en savoir plus
« Système métropolitain toulousain : étudiants et actifs en emploi au cœur des échanges migratoires », Insee Analyses Occitanie n° 80, octobre 2019
« Aire urbaine de Toulouse : les nouveaux arrivants contribuent au maintien d'une population jeune », Insee Analyses Occitanie n° 81, octobre 2019
« Déménagements au sein de l’aire urbaine de Toulouse : des parcours liés aux étapes de la vie », Insee Analyses Occitanie n° 82, octobre 2019