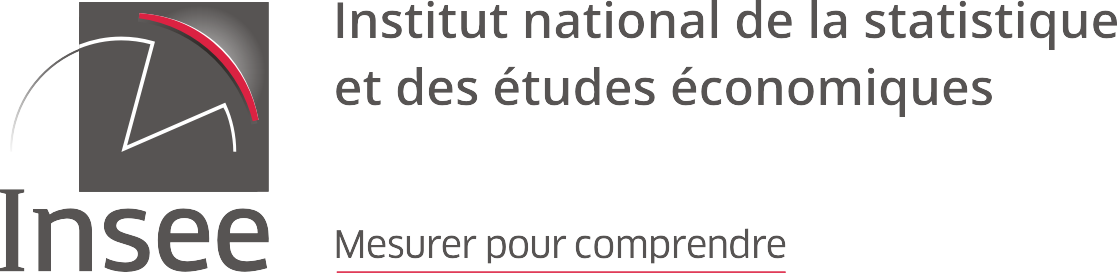Insee Analyses Ile-de-France ·
Septembre 2023 · n° 174
Insee Analyses Ile-de-France ·
Septembre 2023 · n° 174 En Île-de-France, les femmes utilisent moins la voiture et émettent donc moins de
CO2 que les hommes pour aller travailler
En Île-de-France, les femmes utilisent moins la voiture et émettent donc moins de
CO2 que les hommes pour aller travailler
En 2019, en Île-de-France, 5,4 millions d’actifs émettent sur une semaine 47 300 tonnes de CO2 pour leurs déplacements domicile-travail. Ce volume équivaut à 14 % des émissions totales de France métropolitaine alors que les navetteurs franciliens représentent 22 % de l’ensemble des actifs de l’Hexagone. Cela est lié à une plus grande utilisation des transports en commun, notamment pour les personnes travaillant au centre de la région.
Les femmes utilisent moins la voiture que les hommes pour se rendre à leur travail et émettent de ce fait moins de CO2.
Au sein de la région, les émissions diffèrent selon les communes, mais aussi selon l’âge ou la catégorie socioprofessionnelle des navetteurs.
- Davantage d’utilisation des transports en commun en Île-de-France pour aller travailler
- Les navetteurs franciliens utilisent moins la voiture et émettent relativement peu de CO2
- Des émissions de GES nettement réduites à Paris grâce au réseau ferré très dense
- Un usage de la voiture plus fréquent pour les ouvriers
- Des émissions moindres pour les actifs de moins de 30 ans
- Un usage beaucoup plus fréquent de la voiture pour les hommes
- Les émissions de CO2 dépendent avant tout de l’offre et de l’utilisation des transports en commun
- Cinq profils de communes, selon les facteurs qui influent sur les émissions de CO2
- Encadré 1 - Les politiques publiques visant les émissions de gaz à effet de serre et la qualité de l’air
- Encadré 2 - En Île-de-France, le nombre de voitures par adulte et la part de véhicules diesel sont plus faibles qu’en province
Davantage d’utilisation des transports en commun en Île-de-France pour aller travailler
Adoptée en 2015 et révisée en 2018-2019, la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) constitue la feuille de route de la France pour lutter contre le changement climatique, avec pour objectif la neutralité carbone en 2050 (encadré 1). Elle définit une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), dont l’essentiel est constitué de dioxyde de carbone, le CO2. Le secteur des transports est le premier émetteur de GES en France (31 % en 2020 selon le Citepa) et les trajets domicile-travail constituent le premier motif de déplacement des particuliers. Dans ce contexte, la mesure des émissions de GES - et particulièrement de CO2 - liées à ces déplacements constitue un enjeu majeur.
Les navetteurs franciliens utilisent moins la voiture et émettent relativement peu de CO2
En 2019, 5,4 millions d’actifs se déplacent en Île-de-France pour aller travailler, leur lieu de résidence ou leur lieu de travail étant situé dans la région (figure 1). Cumulés sur une semaine, les trajets quotidiens de ces navetteurs franciliens entraînent l’émission d’environ 47 300 tonnes de CO2. S’élevant à 14 %, la part de l’Île-de-France dans les émissions hebdomadaires de CO2 en France métropolitaine liées aux navetteurs est faible au regard de la proportion de navetteurs franciliens (22 %). L’offre de transports en commun, abondante et utilisée massivement par les Franciliens, en est le principal facteur explicatif. Ainsi, 45 % des navetteurs de la région utilisent les transports en commun comme mode de transport principal, contre à peine 8 % en province. La voiture apparaît en deuxième position en Île-de-France, avec 43 % d’utilisateurs quotidiens, alors que les deux-roues motorisés (3 %) et les modes de déplacement doux (7 % pour la marche et 2 % pour le vélo) sont très minoritaires. Les distances des trajets réalisés en voiture sont en moyenne légèrement plus longues que celles des trajets réalisés en transports en commun (17,2 km contre 15,6 km).
En Île-de-France, les émissions moyennes de CO2 par km et par personne d’un déplacement en voiture s’élèvent à 145 grammes (g) et celles d’un déplacement en transports en commun à 5 g seulement. En conséquence, la voiture est à l’origine de 95 % des émissions de l’ensemble des navetteurs franciliens, contre 3 % pour les transports en commun. Par ailleurs, les émissions moyennes de CO2 par km des transports en commun franciliens sont plus de deux fois plus faibles qu’en province (5 g contre 11 g) : en effet, en Île-de-France, la part du réseau ferré, mode de transport à émission nulle en CO2, y est importante, relativement à celle des cars et des bus. Moindre usage de la voiture et moindre pollution liée aux transports en commun concourent conjointement à un meilleur bilan en Île-de-France. Ainsi, un navetteur francilien parcourt à chaque trajet en moyenne 14,9 km contre 14,0 km pour un navetteur d’une autre région, mais ses émissions de CO2 pour chaque km parcouru sont nettement plus faibles qu’un navetteur en province (77,1 g contre 132,1 g).
En Île-de-France, le bilan carbone par personne des navettes domicile-travail est ainsi plus favorable qu’en province. Il l’est encore davantage dans le cœur de l’agglomération, notamment dans la zone à faibles émissions (ZFE) de la métropole du Grand Paris (MGP). En effet, en prenant en compte les navetteurs qui y résident et ceux qui y travaillent, cette zone représente 44 % des émissions de GES de la région alors qu’elle est fréquentée par 66 % des navetteurs franciliens. La majorité de ces derniers (60 %) utilisent les transports en commun et 27 % leur voiture. À l’inverse, la grande majorité (74 %) des navetteurs franciliens dont le trajet se fait hors de la ZFE utilisent leur voiture ; seuls 17 % d’entre eux prennent les transports en commun pour aller travailler.
tableauFigure 1 – Caractéristiques des navetteurs d'Île-de-France et de province en 2019
| Caractéristiques | Île-de-France | Province | France métropolitaine |
|---|---|---|---|
| Nombre de navetteurs (en milliers) | 5 440 | 19 350 | 24 790 |
| Répartition | 21,9 | 78,1 | 100,0 |
| Répartition selon le mode de transport principal | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Marche à pied (ou rollers, patinette) | 6,9 | 6,2 | 6,4 |
| Vélo (y compris à assistance électrique) | 2,4 | 2,5 | 2,4 |
| Deux-roues motorisé | 3,0 | 1,6 | 1,9 |
| Voiture, camion ou fourgonnette | 42,6 | 82,1 | 73,4 |
| Transports en commun | 45,1 | 7,6 | 15,9 |
| Distance moyenne domicile-travail (en km) | 14,9 | 14,0 | 14,2 |
| Émissions de CO2 par personne et par km (en g) | 77,1 | 132,1 | 119,9 |
| Émissions totales de CO2 par semaine (en tonnes) | 47 300 | 284 900 | 332 200 |
| Répartition | 14,2 | 85,8 | 100,0 |
- Lecture : parmi les 5 440 000 navetteurs d'Île-de-France, 3,0 % utilisent un deux-roues motorisé comme mode de transport principal pour aller travailler.
- Champ : actifs navetteurs de France métropolitaine résidant ou travaillant dans le territoire considéré.
- Sources : Insee, recensement de la population 2019 ; SDES, EMP.
Des émissions de GES nettement réduites à Paris grâce au réseau ferré très dense
Avec 32 % des emplois de la région, Paris est un grand pôle d’emploi. Ainsi 31 % des navetteurs d’Île-de-France travaillent à Paris. Leur bilan carbone est particulièrement favorable : leurs émissions de CO2 correspondent à seulement 13 % du total des émissions de CO2 de la région (figure 2). En effet, les navetteurs bénéficient d’un réseau ferré principalement centré sur la capitale permettant ainsi une massification de l’usage des transports en commun sur ces trajets. Parmi les navetteurs travaillant à Paris, 36 % viennent de la petite couronne et 22 % de la grande couronne. Globalement, 72 % des navetteurs travaillant à Paris utilisent les transports en commun.
tableauFigure 2 – Répartition des navetteurs d'Île-de-France et de leurs émissions de CO2, selon des indicateurs socio-démographiques en 2019
| Indicateurs | Part des navetteurs | Part des émissions hebdomadaires de CO2 |
|---|---|---|
| Sexe | ||
| Hommes | 51,4 | 64,2 |
| Femmes | 48,6 | 35,8 |
| Lieu de travail | ||
| Paris | 31,4 | 13,1 |
| Petite couronne | 35,9 | 31,3 |
| Grande couronne | 32,2 | 53,6 |
| Province | 0,5 | 2,0 |
| Catégorie socioprofessionnelle | ||
| Agriculteurs exploitants | 0,1 | 0,1 |
| Artisans, commerçants et chefs d’entreprise | 5,0 | 6,2 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 30,9 | 27,0 |
| Professions intermédiaires | 26,3 | 28,9 |
| Employés | 24,6 | 19,9 |
| Ouvriers | 13,1 | 17,9 |
| Âge | ||
| Moins de 30 ans | 20,3 | 15,2 |
| De 30 à 39 ans | 25,9 | 25,3 |
| 40 ans ou plus | 53,8 | 59,5 |
- Lecture : en 2019, les navetteurs travaillant à Paris représentent 31,4 % des navetteurs d'Île-de-France et génèrent 13,1 % des émissions hebdomadaires régionales de CO2.
- Champ : navetteurs résidant ou travaillant en Île-de-France.
- Sources : Insee, recensement de la population 2019 ; SDES, EMP.
graphiqueFigure 2 – Répartition des navetteurs d'Île-de-France et de leurs émissions de CO2, selon des indicateurs socio-démographiques en 2019

- Lecture : en 2019, les navetteurs travaillant à Paris représentent 31,4 % des navetteurs d'Île-de-France et génèrent 13,1 % des émissions hebdomadaires régionales de CO2.
- Champ : navetteurs résidant ou travaillant en Île-de-France.
- Sources : Insee, recensement de la population 2019 ; SDES, EMP.
Un usage de la voiture plus fréquent pour les ouvriers
Les émissions de CO2 varient beaucoup selon la catégorie socioprofessionnelle des navetteurs. Cela tient notamment à des différences dans les lieux de travail ou de résidence. Disposant de lieux de travail souvent situés dans des zones denses, les employés bénéficient d’une offre abondante de transports collectifs. Les employés représentent un quart des navetteurs d’Île-de-France mais leurs déplacements professionnels représentent une moindre proportion (un cinquième) des émissions régionales de GES. Le constat est similaire pour les cadres, dont la moitié (51 %) utilisent les transports en commun.
À l’inverse, les ouvriers travaillent plus fréquemment dans des zones industrielles ou artisanales, hors des centres-villes, notamment en grande couronne. Pour s’y rendre, ils sont donc plus souvent contraints d’utiliser la voiture. Seulement 39 % d’entre eux utilisent les transports en commun. De plus, les ouvriers parcourent en moyenne 16,6 km, une distance supérieure à celle de l’ensemble des actifs. Ils sont aussi proportionnellement plus nombreux à se rendre à leur travail cinq jours par semaine, car ils occupent des emplois généralement non télétravaillables. Ainsi, ils ne représentent que 13 % des navetteurs franciliens mais 18 % des émissions régionales de CO2.
Des émissions moindres pour les actifs de moins de 30 ans
Le niveau des émissions de CO2 des navetteurs dépend aussi de leur âge. Les actifs en emploi de moins de 30 ans représentent 20 % des navetteurs d’Île-de-France mais seulement 15 % de leurs émissions. À l’inverse, les actifs de 40 ans ou plus émettent 60 % du CO2 régional alors qu’ils représentent 54 % des navetteurs. Ces écarts de bilan carbone tiennent à des modes de déplacement différents pour aller travailler : seulement 36 % des jeunes actifs utilisent une voiture ou un deux-roues motorisé, alors que c’est le cas de 50 % des actifs plus âgés. Cela s’explique notamment par des lieux de résidence différents, les lieux de travail étant assez comparables. Les navetteurs de moins de 30 ans vivent très majoritairement dans les zones urbaines très denses, bien desservies par les transports en commun. Près d’un quart (23 %) d’entre eux habitent à Paris. Pour les actifs en emploi âgés de 40 ans ou plus, les habitats sont plus éloignés de Paris, et souvent moins bien desservis.
Un usage beaucoup plus fréquent de la voiture pour les hommes
De même, les émissions de CO2 diffèrent entre les hommes et les femmes. Les hommes, légèrement plus nombreux parmi les navetteurs (51 %), utilisent nettement plus souvent que les femmes la voiture ou le deux-roues motorisé (52 % contre 39 %). Ils parcourent aussi une distance en moyenne supérieure (16,3 km contre 13,4 km). Cela s’explique en partie par la présence masculine importante parmi les navetteurs ouvriers (82 %), alors que les hommes sont minoritaires parmi les navetteurs employés (32 %). Mais, même à catégorie sociale égale, les hommes utilisent moins les transports collectifs que les femmes et effectuent des trajets plus longs. Ainsi, les déplacements domicile-travail des hommes sont à l’origine de 64 % des émissions régionales de CO2, contre seulement 36 % pour ceux des femmes.
Les émissions de CO2 dépendent avant tout de l’offre et de l’utilisation des transports en commun
Le mode de transport est déterminant pour le bilan carbone des déplacements domicile-travail. Il peut être contraint ou choisi : il est tributaire de l’accès aux transports en commun, non seulement sur le lieu de résidence mais aussi sur le lieu de travail ; il dépend aussi de la préférence des navetteurs, qui peuvent faire le choix de prendre leur voiture pour diverses raisons (accompagnement des enfants à l’école, temps de trajet plus court, covoiturage…) même avec une bonne desserte. Par ailleurs, les émissions de CO2 dépendent de la distance parcourue et du type de voiture (motorisation, ancienneté, puissance).
Le niveau des émissions de CO2 sur un territoire dépend donc de multiples facteurs : la localisation de la population active et des emplois, à proximité ou non de transports en commun, le maillage en transports en commun, le profil des navetteurs et la distance qu’ils parcourent, que cette commune soit leur lieu de résidence ou leur lieu de travail.
Cinq profils de communes, selon les facteurs qui influent sur les émissions de CO2
En Île-de-France, on peut ainsi distinguer cinq classes de communes (pour comprendre), selon le mode de transport utilisé pour les trajets domicile-travail et le niveau plus ou moins élevé des émissions de CO2 (figure 3).
La première classe de communes est composée de 253 communes, petites, essentiellement rurales, situées aux franges de la région. Le nombre d’emplois y est faible (27 600) et l’accès aux transports en commun, limité. Les distances parcourues par les navetteurs sont donc importantes (en moyenne 31 km pour ceux qui résident dans ces communes) et souvent effectuées en voiture. En outre, le parc automobile y est ancien (21 % de voitures classées Crit’Air 4 ou 5 ou non classées). Les émissions de CO2 sont donc élevées (28,6 kg par semaine et par navetteur). Néanmoins, du fait de sa faible densité en population et en emploi, cette classe ne représente que 3 % des émissions de la région.
La deuxième classe regroupe 302 communes accueillant une population peu favorisée (niveau de vie médian relativement bas), dont les actifs résidents sont pour beaucoup éloignés de leur emploi (en moyenne de 18 km). De plus, la population active de ces communes compte peu de cadres (14 %). Du fait d’une forte implantation d’établissements de l’industrie ou de la construction, 21 % des emplois sont occupés par des ouvriers. Ces communes sont bien desservies par le réseau de transports en commun, mais l’utilisation de la voiture est majoritaire, notamment pour ceux qui y travaillent. Le parc automobile des résidents est ancien. Les émissions de CO2 sont supérieures à la moyenne régionale (10,4 kg par semaine et par navetteur). Globalement, elles représentent 26 % des émissions totales de la région.
La troisième classe est composée de 501 communes localisées essentiellement en grande couronne. La desserte en transport ferroviaire y est bonne. Les cadres sont sous-représentés dans la population active (26 %), de même que les ouvriers dans les emplois (17 %). La voiture est, là encore, le principal mode de déplacement pour les trajets professionnels, longs de 18 km en moyenne. Avec 1,9 million de navetteurs émettant en moyenne 11,1 kg de CO2 par semaine, cette classe de communes représente plus d’un tiers des émissions de CO2 de la région (35 %).
La quatrième classe regroupe 151 communes, situées en grande partie dans les Yvelines. Même si la voiture reste prédominante, les transports en commun y sont bien plus utilisés par la population active que dans la première classe (36 % contre 11 %). Les cadres représentent près de la moitié des actifs résidents (45 %). Le parc automobile des résidents est assez récent. Les trajets professionnels sont proches de la moyenne régionale (14 km contre 15 km), de même que les émissions moyennes par navetteur (8,5 kg par semaine). Cette classe représente 10 % des émissions de CO2 de la région.
Enfin, la dernière classe comprend 56 communes de petite couronne et 4 communes de grande couronne qui sont limitrophes de la petite couronne (Vélizy-Villacoublay, Viroflay, Deuil-la-Barre et Sarcelles), ainsi que tous les arrondissements de Paris. Ces territoires sont très bien desservis par les transports en commun (métro, tramway, RER, Transilien), qui sont très majoritairement utilisés. Cette classe regroupe 56 % des emplois franciliens, parmi lesquels beaucoup relèvent de fonctions de cadre. En moyenne, les navetteurs parcourent des distances très courtes (8 km) et émettent peu de GES (3,1 kg par semaine). Toutefois, composée de communes fortement peuplées, cette classe représente un quart des émissions de CO2 de la région.
tableauFigure 3 – Typologie des communes d’Île-de-France selon les déterminants des émissions de CO2
| Caractéristiques | Ensemble des communes d’Île-de-France | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actifs au lieu de résidence | 5 261 000 | 70 900 | 1 067 200 | 1 440 000 | 507 700 | 2 175 200 |
| Distance moyenne parcourue par les actifs qui résident dans la zone (en km) | 15 | 31 | 18 | 18 | 14 | 8 |
| Distance moyenne parcourue par les actifs qui travaillent dans la zone (en km) | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 |
| Proportion d’actifs résidents allant travailler en transports en commun (en %) | 46 | 11 | 39 | 34 | 36 | 60 |
| Émissions hebdomadaires moyennes de CO2 par navetteur (résidant ou en emploi dans la zone) (en kg) | 8,7 | 28,6 | 10,4 | 11,1 | 8,5 | 3,1 |
| Part des émissions totales de CO2 de la région (en %) | 100 | 3 | 26 | 35 | 10 | 26 |
- Note : les données par commune sont dans le fichier en téléchargement.
- Lecture : les arrondissements de Paris sont tous dans la classe 5. Les émissions de CO2 des communes de la classe 3 représentent 35 % des émissions totales de l’Île-de-France.
- Sources : Insee, recensement de la population 1999 ; SDES, EMP.
graphiqueFigure 3 – Typologie des communes d’Île-de-France selon les déterminants des émissions de CO2

- Note : les données par commune sont dans le fichier en téléchargement.
- Lecture : les arrondissements de Paris sont tous dans la classe 5. Les émissions de CO2 des communes de la classe 3 représentent 35 % des émissions totales de l’Île-de-France.
- Sources : Insee, recensement de la population 1999 ; SDES, EMP.
Encadré 1 - Les politiques publiques visant les émissions de gaz à effet de serre et la qualité de l’air
Adoptée en 2015 et révisée en 2018-2019, la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) vise la neutralité carbone en 2050. Elle définit ainsi une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, basée sur des budgets carbone.
La politique de lutte contre le changement climatique s’accorde avec les autres politiques publiques touchant le secteur des transports, en particulier l’aménagement du territoire et la qualité de l’air.
Le plan de protection de l’atmosphère (PPA) définit pour l’ensemble de la région les objectifs et les actions de l’État et de ses partenaires permettant de ramener les concentrations d’oxydes d’azote et de particules au-dessous de valeurs limites pour assurer la qualité de l’air. Il vise tous les secteurs d’activité selon leur contribution aux émissions régionales. Il est actuellement en cours de révision en Île-de-France.
Le schéma régional climat air énergie (SRCAE) est un document stratégique qui définit les grands objectifs et les grandes orientations de la Région en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande d’énergie, de développement des énergies renouvelables, de qualité de l’air et d’adaptation au changement climatique. Il est actuellement en cours de révision en Île-de-France.
En appui, les collectivités territoriales se sont engagées le 29 mars 2018 sur une feuille de route pour la qualité de l’air 2018-2025.
Par ailleurs, la loi d’orientation des mobilités impose aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 100 000 habitants, ou à ceux couverts en tout ou partie par un PPA, d’intégrer dans leur plan climat air énergie territorial (PCAET) un plan d’action qualité de l’air (PAQA). Les PAQA doivent fixer des objectifs biennaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques au moins aussi exigeants que ceux prévus au niveau national par le Plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA) et doivent proposer des actions permettant d’atteindre ces objectifs de réduction d’émission et de respecter les normes de qualité de l’air dans les délais les plus courts possibles, au plus tard en 2025.
Enfin, le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF-E), arrêté le 12 juillet 2023 par le conseil régional, a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l’utilisation de l’espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région. Il précise les moyens à mettre en œuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner l’offre de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d’assurer les conditions d’un développement durable de la région.
Encadré 2 - En Île-de-France, le nombre de voitures par adulte et la part de véhicules diesel sont plus faibles qu’en province
En 2019, le parc automobile des ménages franciliens comprend 4 516 000 véhicules, soit 0,48 voiture en circulation par adulte. C’est peu en comparaison des autres régions, où cette proportion atteint 0,71. L’offre et l’usage importants des transports en commun contribuent à expliquer ce faible ratio pour l’Île-de-France et surtout à Paris (0,24).
Les véhicules diesel sont nettement moins majoritaires que dans le reste de la France métropolitaine (50 % contre 61 %). Les voitures essence représentent 49 % du parc francilien. De fortes disparités s’observent selon les départements : en Seine-et-Marne et en Seine-Saint-Denis, les véhicules roulant au diesel représentent plus de 58 % du parc automobile.
Les diesels étant sous-représentés en Île-de-France, la part des voitures éligibles aux vignettes Crit’Air 4 ou 5 ou non classées (16 %) est inférieure à celle de province (20 %). Il existe toutefois de fortes disparités territoriales puisque cette part varie de 13 % dans les Hauts-de-Seine à 22 % en Seine-Saint-Denis. Dans la zone à faibles émissions (ZFE) du Grand Paris, qui concentre un tiers du parc automobile de la région, 15 % des voitures appartiennent à cette catégorie. À l’opposé, la proportion de véhicules Crit’Air 0 et 1 est plus élevée en Île-de-France (25 %) que dans les autres régions (19 %).
Le classement des véhicules selon leur vignette Crit’Air dépend de la date de leur mise en circulation. Il ne reflète pas nécessairement des écarts d’émissions de polluants. Ainsi, du fait de la part plus élevée en Île-de-France des voitures essence, les émissions moyennes de CO2 par km d’un véhicule de la région sont un peu supérieures à celles d’un véhicule de province (160,6 g contre 157,6 g).
Pour comprendre
La typologie des communes en cinq classes a été réalisée en deux étapes. La première a consisté en une analyse en composantes principales (ACP) sur huit caractéristiques des communes : distance parcourue par les actifs résidents, distance parcourue par les actifs qui travaillent dans la commune, part de cadres dans la population active, part des emplois d’ouvriers dans l’ensemble des emplois, part des voitures Crit’Air 4 ou 5 ou non classées dans le parc automobile des ménages, niveau de vie médian en euros, part des résidents situés à moins de 10 minutes à pied d’une station de tram ou de métro, part des résidents situés à moins de 10 minutes à pied d’une gare ferroviaire. La seconde étape a consisté en une classification ascendante hiérarchique (CAH) sur les coordonnées des communes sur les cinq premiers axes de l’ACP.
Le Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (Citepa) est une association à but non lucratif qui évalue l’impact des activités humaines sur le climat et la pollution atmosphérique. C’est un opérateur de l’État.
Le Service des données et des statistiques (SDES) est un service du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.
Sources
L’étude est basée sur un outil développé conjointement par l’Insee et le SDES permettant de :
- décrire les comportements de mobilité selon les caractéristiques socio-démographiques des actifs en emploi ;
- analyser les principaux facteurs d’émissions de CO2 : ampleur des flux, distances parcourues, modes de transport utilisés, caractéristiques du parc automobile ;
- estimer, sur un territoire donné, les émissions de CO2 des trajets domicile-travail et leur part dans l’ensemble des déplacements.
Les sources utilisées sont le recensement de la population 2019, l’enquête mobilité des personnes (EMP) 2018-2019, le répertoire statistique des véhicules routiers et les estimations du parc roulant 2019.
Définitions
Les gaz à effet de serre (GES) sont des gaz d’origine naturelle ou anthropique, absorbant et réémettant une partie des rayons solaires sous la forme de radiations au sein de l’atmosphère terrestre, phénomène qui est à l’origine de l’effet de serre et donc du réchauffement climatique. Les principaux GES d’origine anthropique en volume sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O) et les gaz fluorés.
Dans cette étude, les navetteurs sont les actifs résidant en Île-de-France ainsi que les actifs résidant en province et travaillant en Île-de-France. Les personnes qui ne se déplacent pas pour aller travailler sont exclues du champ de l’étude. Il en est de même pour les actifs dont la distance domicile-travail est supérieure à 10 km pour les piétons, 30 km pour les vélos et 100 km pour les autres modes de transport. Ainsi 230 000 navetteurs dont le lieu de travail est situé à plus de 100 km du lieu de résidence ne sont pas considérés dans cette étude. Une navette désigne un trajet entre le domicile et le travail. Un aller-retour correspond donc à deux navettes. Le nombre de navettes effectuées sur une semaine tient compte du temps partiel et du télétravail.
Les émissions hebdomadaires de CO2 représentent la quantité de CO2 émise pour les déplacements domicile-travail pour une semaine moyenne, y compris le week-end et les vacances.
Le dispositif de zone à faibles émissions (ZFE) consiste à interdire l’accès à tout ou partie d’un territoire aux véhicules les plus polluants (le classement des véhicules en fonction de leurs émissions polluantes en particules fines et oxydes d’azote se fait au moyen de la vignette Crit’Air allant de 0 à 5, 5 étant la classe la plus polluante) pendant une période donnée, dans l’objectif d’améliorer la qualité de l’air et de protéger la santé des populations. En Île-de-France, la ZFE englobe l’ensemble du périmètre de l’autoroute A86.
Pour en savoir plus
(1) Citepa, « Ouvrir dans un nouvel ongletGaz à effet de serre et polluants atmosphériques. Bilan des émissions en France de 1990 à 2022. Rapport Secten », édition 2023.
(2) Boussad N., Chaput K., Sarron C., Tissot I., Touahir M., « Objectifs du développement durable : regards sur l’Île-de-France », Insee Dossier Île-de-France no 7, janvier 2022.
(3) Bayardin V., Jabot D., « En Île-de-France, la moitié des actifs parcourent plus de neuf kilomètres pour aller travailler », Insee Flash Île-de-France no 60, septembre 2021.
(4) Sarron C., Trevien C., « Se déplacer en voiture : des distances parcourues une fois et demie plus importantes pour les habitants des couronnes que pour ceux des pôles », in La France et ses territoires, coll. « Insee Références », édition 2021.
(5) Martin J.-Ph., Pichard L., « Près de 60 % des actifs travaillant à Paris ne résident pas dans la capitale », Insee Flash Île-de-France no 55, février 2021.
(6) Arrêté du 21 juin 2016 établissant la Ouvrir dans un nouvel ongletnomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques.