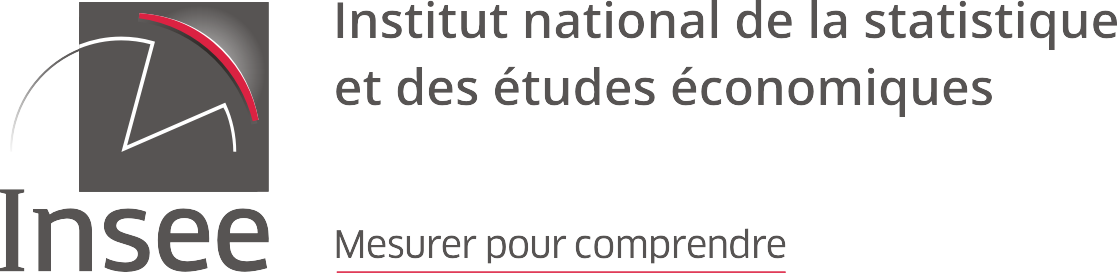Courrier des statistiques N7 - 2022
Courrier des statistiques N7 - 2022
Le recensement agricole de 2020 Cinq innovations qui feront date
Opération internationale et décennale, le recensement agricole ambitionne de produire une photographie complète du monde agricole. Cette opération majeure de la statistique agricole est au cœur de son système d’information. L’édition de 2020 a été conduite entre octobre 2020 et mai 2021, malgré le contexte sanitaire, en s’appuyant sur cinq innovations majeures impactant les enquêtés, les enquêteurs et les statisticiens.
Pour la première fois, le recensement a été collecté majoritairement par internet ou par téléphone. Le terrain reste l’apanage des enquêteurs du réseau agricole, notamment dans les départements d’Outre-mer. Mais le recours à des prestataires spécialisés permet de développer des alternatives au face-à-face, plus adaptées aux contraintes des enquêtés. Le multimode a été doublé d’un recours massif aux données administratives, afin d’alléger la charge de réponse et d’améliorer la qualité des données. Pour faciliter l’adhésion à ces nouveaux modes de collecte, une démarche inspirée du Nudge a conduit à repenser les supports de communication. Enquêteurs et prestataires ont par ailleurs bénéficié d’une formation à distance : en soi c’est une petite révolution pour une opération plus que centenaire. Enfin, le plan de sondage des modules complémentaires sur l’élevage et la main-d’œuvre a été optimisé.
- Le recensement agricole, essentiel pour le pilotage des politiques publiques...
- ... qui s’inscrit dans un cadre international
- Définir les unités statistiques dans le champ du recensement
- Encadré 1. Des règles en cascade pour entrer dans le champ du recensement agricole
- Pour constituer l’univers statistique du recensement, on a fait feu de tout bois
- Le multimode : une avancée majeure pour le recensement de 2020 en France
- Premier retour d’expérience sur le recours à des prestataires externes
- Le face-à-face avec les enquêteurs agricoles, pour approfondir certaines thématiques
- La formation en ligne : une idée qui tombe à pic en période de crise sanitaire...
- Encadré 2. Une collecte adaptée dans les départements d’Outre-mer
- Une communication vers les enquêtés repensée selon les principes du Nudge
- Un nouveau plan de sondage pour les modules thématiques
- La collecte des 900 variables s’appuie largement sur les données administratives...
- ... avec parfois quelques difficultés
- Le recensement agricole c’est (vraiment) simple et rapide
- Encadré 3. Le recensement agricole 2020 en chiffres
- Fondements juridiques
Tous les dix ans, le recensement agricole permet de collecter de nombreuses données sur l’ensemble des exploitations françaises. Opération centrale de la statistique agricole, le recensement est aussi une des plus importantes opérations statistiques réalisées en France.
Le recensement concerne l’ensemble des exploitations agricoles, qu’elles soient grandes ou petites, que l’agriculture corresponde à l’activité principale ou secondaire de l’exploitant. Afin d’assurer une couverture complète du monde agricole, ce sont ainsi plus de 500 000 unités qui sont interrogées.
Pour chaque exploitation, plus de 900 données sont recueillies sur les superficies cultivées, les cheptels, la main-d’œuvre, les modes de production et de commercialisation ainsi que les activités de diversification et de transformation des produits à la ferme. Le recensement fournit ainsi une photographie précise et exhaustive du monde agricole et de sa diversité, en France métropolitaine mais aussi dans les départements d’Outre-mer.
L’agriculture est en constante adaptation, faisant écho aux évolutions de la société. Le secteur utilise les technologies informatiques, diversifie ses modes de commercialisation et ses débouchés, revoit ses pratiques pour préserver l’environnement, développe des labels de qualité, etc. C’est toute la réalité des professionnels du monde agricole qui change. De même, le recensement agricole se devait d’évoluer et la collecte 2020 a ouvert la voie à plusieurs innovations structurantes.
Le recueil des données est désormais réalisé en majorité par internet ou par téléphone. L’ensemble de la communication adressée aux enquêtés a été révisée. Le volet de données complémentaires sur la main-d’œuvre et les bâtiments d’élevage est collecté sur un échantillon pour lequel le plan de sondage a été optimisé. Les enquêteurs ont été formés en ligne. Autant d’innovations qui ont facilité la poursuite de la collecte malgré le contexte sanitaire imposé par la Covid-19.
Le recensement agricole, essentiel pour le pilotage des politiques publiques...
Du fait de leur exhaustivité, les données des recensements constituent des références importantes pour tous les acteurs du monde agricole : exploitants, organisations professionnelles, syndicats, chercheurs, pouvoirs publics, etc. Elles permettent d’analyser l’agriculture française et ses évolutions, et d’en mesurer le poids au sein de l’Union européenne. L’agriculture est certes un secteur stratégique en tant que secteur économique, mais aussi pour son rôle dans l’indépendance alimentaire, face à l’augmentation de la population et au changement climatique. Dans ce contexte, les résultats du recensement agricole vont contribuer au pilotage et à l’évaluation des politiques publiques agricoles et alimentaires, mises en œuvre aux échelons régional, national, et communautaire.
Les données du recensement permettent également de quantifier des mesures liées au développement durable et aux politiques agro-environnementales, et d’évaluer les politiques de soutien économique aux exploitations. Les résultats du précédent recensement ont par exemple été utilisés pour simuler des modifications apportées dans les règles de classement des territoires éligibles à l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN). Cette aide vient soutenir les agriculteurs installés dans des territoires où les conditions de production sont plus difficiles qu’ailleurs, du fait de contraintes naturelles ou spécifiques.
Le recensement agricole permet d’évaluer l’état de l’agriculture, mais aussi sa position et son évolution, en comparant les résultats à ceux des précédents recensements, ou à ceux des autres pays européens. Ce besoin d’information sur le secteur agricole dépasse de loin le seul cadre national.
... qui s’inscrit dans un cadre international
La FAO, l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture1, a établi un programme mondial et élaboré des concepts et des méthodes pour appuyer la réalisation coordonnée des recensements agricoles dans le monde (Ouvrir dans un nouvel ongletFAO, 2020).
Au sein de l’Union européenne, le règlement sur les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles (IFS – Integrated Farm Statistics) organise la réalisation du recensement dans les 27 États membres (Eurostat, 2020).
Les périodes de collecte sont harmonisées. Si un socle commun d’informations doit être transmis à Eurostat par l’ensemble des pays, chacun peut également décider d’ajouter des questions pour répondre à des besoins nationaux.
Entre deux recensements décennaux, sont intercalées des enquêtes sur la Structure des exploitations agricoles (Esea) pour actualiser les données (figure 1). Les prochaines Esea seront menées en 2023 et 2026.
Figure 1. Un dispositif européen complet, modulaire, étalé dans le temps
Le règlement européen distingue par ailleurs deux types de données : un tronc commun devant être renseigné exhaustivement pour chaque exploitation et huit modules pouvant être collectés par échantillon. En 2020, les trois modules à collecter portaient sur la main-d’œuvre, le développement rural et le logement des animaux. En 2023, le module sur le logement des animaux sera remplacé par quatre modules : irrigation, gestion du sol, machines et équipements, vergers.
Les États membres doivent être en mesure de garantir la qualité des données collectées, mais restent libres de choisir la façon dont ils obtiennent les informations demandées : questionnement par internet, par téléphone, en face-à-face, mobilisation de sources administratives, etc. La collecte par internet a été développée dans de nombreux pays (Autriche, Allemagne, Espagne, etc.).
L’organisation du recensement agricole de l’année 2020 a été touchée par la pandémie de Covid-19 dans la plupart des pays de l’Union européenne. Celle-ci a retardé plusieurs activités, notamment la préparation des outils de collecte, la diffusion d’informations aux personnes interrogées, le recrutement des enquêteurs, la formation du personnel et la collecte des données elle-même. Toutefois, le contexte sanitaire a aussi ouvert la voie à une modernisation du processus de collecte et des méthodes de travail. Plusieurs pays, dont la France, ont ainsi davantage eu recours aux sources de données administratives et à la collecte des questionnaires par internet et par téléphone.
Mais quand on parle de recensement, on pense d’abord à s’assurer de son exhaustivité.
Définir les unités statistiques dans le champ du recensement
Un recensement se doit d’être exhaustif. C’est la raison pour laquelle, la première question à régler est celle de l’univers statistique de cette opération. Toutes les exploitations agricoles sont interrogées dans le recensement agricole, aussi bien en France métropolitaine que dans les départements d’Outre-mer. Mais une seule personne sur chaque exploitation est invitée à répondre à l’enquête : c’est en général le chef d’exploitation, même dans les cas où l’agriculture ne constitue pas son activité principale.
Certaines unités interrogées s’avéreront ex-post comme hors champ du recensement agricole : pour ne retenir dans les résultats que les exploitations dépassant une certaine dimension économique, des règles sont appliquées à partir des caractéristiques de l’exploitation relevées lors du recensement (superficie cultivée, nature de la production, etc.) (encadré 1). Ces règles s’appuient sur des seuils, définis aux niveaux européen et national. Les seuils retenus au niveau national sont généralement plus bas qu’au niveau européen. Ils sont calqués pour la plupart sur ceux en vigueur lors du précédent recensement (2010) afin de permettre une continuité dans les séries statistiques. Le règlement européen sur les statistiques agricoles (IFS, voir infra) fixe ainsi un seuil de surface agricole utilisée (SAU) minimale de 5 ha, contre 1 ha pour le seuil français.
Le respect de ces conditions assure en théorie que l’exploitation retenue est un acteur économique en capacité à participer à une transaction commerciale à partir de sa production.
Mais comment établir ex-ante la liste des unités statistiques qui constituent le champ de la collecte ?
Pour constituer l’univers statistique du recensement, on a fait feu de tout bois
Lors du recensement de 2010, le service de la Statistique et de la prospective (SSP) avait fait appel aux 36 000 communes qui devaient vérifier des listes d’exploitants agricoles sur leur territoire, établies par les services régionaux (Srise). Ce travail, certes utile, était cependant sujet à erreurs d’interprétation sur le concept d’exploitation agricole, omissions, bref de qualité très hétérogène.
Pour éviter ce travers, l’univers statistique du recensement de 2020 a été délibérément établi sur une large base d’informations déjà disponibles. Partant du répertoire des entreprises (Sirene), géré en continu à partir des créations et cessations déclarées, il a été complété avec les fichiers administratifs du monde agricole : déclarations dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), casier viticole informatisé, fichiers des mouvements des animaux, mutualité sociale agricole (MSA) et à l’aide des enquêtes thématiques réalisées par le service de la statistique et de la prospective (SSP).
Un important travail a été ensuite réalisé pour actualiser les coordonnées des exploitations, en particulier les courriels et numéros de téléphone. Ainsi a été constitué un référentiel, la base de sondage des exploitations agricoles (Balsa), en rénovation dès 2021 pour qu’à terme, les données du recensement agricole permettent de valider l’univers des exploitations et que l’intégration de données administratives soit annualisée et automatisée. Ceci fait du recensement un élément central pour les autres opérations de la statistique agricole.
Le multimode : une avancée majeure pour le recensement de 2020 en France
En France, le recensement agricole a depuis son origine été collecté en face-à-face par des enquêteurs. Lors de l’édition de 2010, les enquêteurs avaient pour la première fois été dotés d’ordinateurs pour contrôler en direct les données saisies. Mais c’est la mise en œuvre d’une véritable collecte multimode qui aura constitué la principale innovation du recensement agricole de 2020.
La refonte du mode de collecte poursuivait deux objectifs. Tout d’abord, la collecte par internet devait faciliter la remontée des données : le service est ouvert 24 h/24 et 7 j/7, les exploitants peuvent donc renseigner le questionnaire au moment qui leur convient le mieux, en fonction du planning de travail imposé par la conduite de leur exploitation. Elle devait également permettre d’alléger la charge du service statistique.
Concrètement, en 2020 et pour la métropole, le service statistique agricole a donc choisi de mobiliser les trois modes, internet, téléphone et face-à-face (figure 2) :
- le tronc commun était dans la plupart des cas proposé via un questionnaire internet ;
- pour les personnes sans accès à internet ou rencontrant des problèmes informatiques, il était possible de basculer sur la collecte par téléphone, faisant appel à des prestataires externes ;
- les exploitations de l’échantillon concerné par les modules ont été interrogées en face-à-face par des enquêteurs du réseau de la statistique agricole, pour les modules comme pour le tronc commun ;
- les non-répondants à la collecte par internet ou par téléphone ont été in fine relancés par des enquêteurs.
La collecte s’est déroulée entre octobre 2020 et mai 2021.
Figure 2. Deux protocoles multimode pour deux niveaux de détail des données collectées
Premier retour d’expérience sur le recours à des prestataires externes
Près de 400 000 unités ont été invitées à répondre au questionnaire par internet, de manière sécurisée. Pour ce faire, elles ont reçu au préalable un courrier sur lequel figuraient identifiant, mot de passe et lien vers le site de collecte, ainsi que les coordonnées de l’assistance : numéro vert gratuit, et adresse mail de contact. Après un certain temps, en l’absence de connexion, des relances par mail d’abord, puis par téléphone, ont été effectuées pour inciter à répondre au questionnaire en ligne. Enfin, dans une troisième phase, la collecte était réalisée par téléphone.
Deux instituts de sondage ont été retenus pour assurer la collecte par téléphone. Chaque prestataire était chargé de six régions de France métropolitaine, et devait dérouler le protocole par vagues successives d’une durée maximale de trois mois, afin de lisser l’activité de leur plateau téléphonique. Les prestataires ont également relancé par SMS les non-répondants dont on connaissait le numéro de téléphone portable.
Les plateaux téléphoniques étaient associés à un système d’information dédié, permettant d’optimiser le rythme des appels et d’automatiser certaines tâches, par exemple la prise d’appel. Ces outils ont permis au SSP de réaliser une économie de coût pour la collecte des unités du tronc commun.
La durée cumulée de passation du questionnaire internet et téléphone, telle que constatée par les prestataires, a été de 20 à 25 minutes en moyenne, contre 50 minutes pour la collecte en face-à-face. Ceci s’explique aisément par la différence de longueur du questionnaire : en face-à-face il intégrait, en plus du tronc commun, des questions sur les trois modules.
Les prestataires ont obtenu un taux de retour de 91 %. Ce taux varie principalement en fonction du degré de connaissance des coordonnées au moment de la collecte. L’ensemble des unités interrogées par les prestataires pour la collecte par internet et par téléphone avait été classé en cinq groupes, allant du groupe 1 où toutes les coordonnées étaient renseignées (téléphone fixe, téléphone mobile, courriel) au groupe 5 où seule l’adresse postale était connue.
Le face-à-face avec les enquêteurs agricoles, pour approfondir certaines thématiques
Près de 70 000 exploitations dont le siège est situé en France métropolitaine ont été tirées dans un échantillon représentatif et ont ensuite été interrogées sur la base du questionnaire dit « complet », plus détaillé, car comportant, outre le tronc commun, les trois modules de 2020. L’échantillonnage a conduit à généraliser ce type de collecte à toutes les exploitations de Corse et des départements d’Outre-mer.
La collecte en face-à-face, ainsi que la relance des non-répondants au tronc commun, a été réalisée par le réseau des enquêteurs du service statistique ministériel de l’Agriculture. Ce réseau existe depuis de nombreuses années, il est composé d’environ 850 personnes, en grande partie issues du monde agricole (agriculteurs ou anciens agriculteurs, conjoints d’exploitants notamment), ce qui lui confère une forte compétence et une certaine légitimité lors de la conduite des enquêtes en face-à-face. II a été renforcé par près de 300 personnes recrutées pour les besoins du recensement.
Malgré le contexte lié à la pandémie de Covid-19, les enquêteurs ont souligné la qualité de l’accueil que leur ont réservé les agriculteurs, « des gens passionnés par leur travail et qui aiment en parler ».
Accompagnés par un gestionnaire du service régional statistique, notamment lors des premiers entretiens, les enquêteurs ont bénéficié d’une formation d’un nouveau genre, qui constitue la deuxième innovation majeure de ce recensement de 2020.
La formation en ligne : une idée qui tombe à pic en période de crise sanitaire...
Jusqu’en 2019, sur l’ensemble du dispositif d’enquêtes agricoles, toutes les formations des enquêteurs étaient assurées par les services régionaux de statistique agricole (Srise), eux-mêmes formés par les responsables de l’enquête au niveau national (SSP).
Plusieurs problèmes étaient posés par ces modalités de formation. Des déperditions étaient parfois constatées dans la transmission des consignes aux formateurs régionaux puis aux enquêteurs. Par ailleurs, elles généraient une lourde charge logistique pour trouver près de 80 lieux de formation, et gérer les déplacements des enquêteurs. A posteriori, on imagine que ces difficultés auraient été particulièrement accrues avec les restrictions de circulation et de regroupement imposées par la crise sanitaire de 2020.
Une première expérimentation de formation des enquêteurs en ligne avait été conduite dès 2019 avec l’enquête Teruti. Elle s’est traduite par la bonne participation du réseau d’enquêteurs, dont une majorité a d’ailleurs fait part de sa satisfaction, jugeant positivement les outils développés et appréciant de ne pas avoir à se déplacer loin de leur domicile. La principale difficulté provenait de la mauvaise voire de l’absence de connexion à internet.
Riche de ces enseignements, l’équipe en charge du recensement agricole a conçu une formation en ligne en collaboration avec des membres du réseau de formateurs régionaux. La collaboration des Srise, dans le cadre d’un groupe de travail chargé de la conception des supports, a été particulièrement importante pour la réussite de cette opération. La mise en place d’une formation en ligne constitue en effet un grand changement dans les relations entre les gestionnaires d’enquête en Srise et le réseau d’enquêteurs.
Cette formation a été montée avec une structure calquée sur celle du questionnaire du recensement. La plate-forme de formation reprend l’identité graphique du questionnaire et des applications de saisie afin que l’enquêteur puisse faire le lien facilement entre la collecte et les concepts exposés en formation. Pour chaque partie, une vidéo introductive décrit les points qui sont abordés dans les modules qui suivent. Chaque module est constitué d’un diaporama animé et commenté, présentant les concepts à maîtriser. Enfin des quiz sont proposés afin que l’enquêteur puisse vérifier sa compréhension et sa mémorisation des consignes.
Afin de faciliter la réutilisation ultérieure des modules de formation, le choix a été fait de ne pas citer dans les commentaires les caractéristiques propres au recensement agricole, telles que la formulation littérale de chaque question ou le millésime de la campagne de cultures par exemple. Ainsi, certains modules pourront être réutilisés dans le cadre des futures enquêtes menées par le SSP, assurant ainsi une cohérence dans les concepts manipulés dans l’ensemble de la statistique agricole.
Le programme de formation est adapté à chaque type de questionnaire. Des modules spécifiques ont ainsi été développés pour les départements d’Outre-mer, dont les modalités de questionnement ont été adaptées (voir encadré 2).
Un compte individuel a été créé pour chaque enquêteur. Ainsi, les gestionnaires d’enquête des Srise, qui constituaient auparavant le réseau des formateurs en région, pouvaient suivre l’activité de formation de tous les enquêteurs qui leur sont rattachés. Si 1 123 comptes enquêteurs ont été créés, seulement 943 enquêteurs ont de fait été formés en ligne. Une solution hors connexion a donc été proposée à ceux qui rencontraient des problèmes d’accès internet. Les supports ont également été utilisés par les prestataires pour former leurs propres opérateurs des plateformes téléphoniques.
Encadré 2. Une collecte adaptée dans les départements d’Outre-mer
Dans les DOM, l’intégralité de la collecte a été réalisée par les enquêteurs du service statistique agricole. La collecte est réalisée le plus souvent en face-à-face, quelquefois par téléphone. Ce mode de collecte a été privilégié pour plusieurs raisons.
Hormis en Guyane, le territoire de collecte est moins étendu, facilitant ainsi les déplacements des enquêteurs dans les exploitations. En Guyane, les réseaux de télécommunication ne permettent pas de collecter les informations par téléphone et internet dans les zones éloignées des centres urbains. La barrière de la langue en particulier à Mayotte et en Guyane nécessite parfois la médiation d’un enquêteur local pour s’assurer de la bonne traduction des questionnaires. Enfin, la faiblesse des données administratives dans les DOM conduit à mettre hors champ une part significative des unités identifiées dans l’univers au lancement du recensement.
Le questionnaire utilisé pour les DOM est très proche de celui retenu pour la France métropolitaine. Les principaux aménagements portent sur :
- les cultures (ajout de canne à sucre, banane, café, cacao, etc. et retrait de betteraves, artichaut, etc.) ;
- les cheptels (composition, logement, absence de pâturages collectifs) ;
- les signes et démarches qualité ;
- l’origine de la propriété des terres (indivision, colonages, etc.) ;
- l’irrigation (origine de l’eau) ;
- et la diversification (absence de transformation de céréales mais présence de transformation de tubercules ou de canne à sucre).
Pour la description des surfaces cultivées en légumes, un questionnement spécifique a été prévu pour décrire le plus précisément la complexité de la composition des abattis en Guyane et des jardins mahorais. Les abattis sont des cultures sur brûlis où l’agriculteur implante successivement des espèces à cycle court (gombo, pastèque, aubergine) ou une graminée (maïs), puis des tubercules (dachine, igname), ensuite des espèces à cycle moyen (patates douces) qui céderont la place aux plantes majeures telles que le manioc. De même, dans le jardin mahorais, différentes cultures compatibles forment plusieurs étages de productions. On peut par exemple trouver de la patate douce, des plants d’ananas, un pied de bananier, le tout entouré de cocotiers, de manguiers ou de jacquiers.
Les adresses des exploitations sont souvent moins précises dans les DOM qu’en Métropole. Le questionnaire a été adapté afin de recueillir pour chaque exploitation un lieu-dit, dont le nom a été normalisé et affecté de coordonnées spatiales précises : dans des communes de Guyane qui peuvent avoir la taille d’un département métropolitain, on en percevra tout l’intérêt lors de la diffusion des résultats.
Une communication vers les enquêtés repensée selon les principes du Nudge
Pour garantir de bons taux de réponse par internet, plusieurs leviers d’action sont disponibles, notamment en perfectionnant les courriers et les courriels de relance, l’assistance téléphonique et le site web dédié à la collecte.
Cette démarche s’inscrit dans les actions animées par la direction interministérielle de la transformation publique sur la simplification des documents administratifs (Ouvrir dans un nouvel ongletDITP, 2021). Elles reposent sur les enseignements des sciences comportementales développées notamment par D. Kahneman, D. Ariely, C. Sunstein et R. Thaler. Ces travaux ont montré d’une part l’existence de biais cognitifs dans la prise de décision et d’autre part le caractère prédictif de ces biais de décision : un individu ne prend pas forcément les décisions les plus rationnelles, mais sa décision n’est pas surprenante. Il fait appel, en effet, le plus souvent à un « système » automatique, rapide, lié à l’émotion plutôt qu’à un mode réflexif plus lent. Une démarche d’analyse est alors possible pour utiliser ces biais cognitifs dans le but de faire adopter le comportement souhaité. C’est le principe du Nudge qui va tenter de donner un coup de pouce pour favoriser la réponse par internet.
En se basant sur cette approche, les courriers adressés aux enquêtés ont été revus tant sur le fond que sur la forme, suite à un groupe de travail sollicitant l’avis d’une sélection d’agriculteurs.
L’expérience a d’abord montré l’intérêt de développer la personnalisation des courriers, et de privilégier la formulation à la première personne. Le courrier est donc adressé individuellement et il est signé par la cheffe du service statistique du ministère, car identifier le messager est également important. Le caractère officiel du courrier rassure, une remise en forme a donc été nécessaire pour respecter la charte gouvernementale de communication (figure 3).
Figure 3. Une application des principes du Nudge aux courriers du recensement agricole
Des formulations plus incitatives ont également été recherchées. L’enquêté adopte le « bon » comportement lorsqu’il a un minimum de cadrage. La saillance a été travaillée pour attirer l’attention sur les éléments importants, qui devaient être facilement identifiés, en particulier sur les trois étapes de la connexion au questionnaire. Le visuel utilisé (trois étapes, trois icônes) contribuait à mettre en évidence le message souhaité : « Le recensement agricole, c’est simple et rapide ». La nouvelle version du courrier se distingue donc des versions utilisées antérieurement par un visuel plus graphique et aéré et une formulation plus didactique.
Enfin, des éléments ont été ajoutés en cours d’enquête sur le site pour montrer que nombreux étaient les autres exploitants qui avaient déjà répondu : ce faisant, la norme sociale contribuait alors à déclencher une réponse chez ceux qui s’étaient jusque-là abstenus. D’autres améliorations ont été apportées pour rendre plus visible le numéro vert, ajouter une adresse postale de contact, certains exploitants souhaitant envoyer un courrier, bref rendre l’opération la plus simple possible pour les enquêtés.
Un nouveau plan de sondage pour les modules thématiques
En théorie, un recensement, par son caractère exhaustif, ne fait pas appel à un plan de sondage. Mais pour conserver la possibilité de collecter la majorité des exploitations par internet, il était important que le questionnaire ne soit pas trop long et trop complexe. En outre, le nouveau règlement européen permettait de basculer une partie de la collecte sur des enquêtes par sondage. C’est pourquoi, il a été décidé que les questions prévues dans les modules complémentaires (portant sur les bâtiments d’élevage et sur la main-d’œuvre) ne soient pas posées à toutes les exploitations agricoles mais seulement à un échantillon. Ce premier échantillon pour un recensement agricole a été construit pour produire des résultats représentatifs à l’échelle départementale.
En termes de volume de données collectées et de nombre d’exploitations interrogées, l’échantillon du recensement de 2020 est comparable à une enquête Structure (Esea), enquête intercalaire réalisée deux fois entre chaque recensement (voir supra), dont la dernière édition était relativement récente (2016). Plutôt que de reproduire l’échantillonnage des Esea, il a été décidé de conduire, dans le cadre du recensement de 2020, une révision intégrale du plan de sondage, selon deux axes :
- l’optimisation de la stratification, en s’appuyant principalement sur deux variables fortement corrélées aux variables collectées, à savoir l’orientation technique de l’exploitation (Otex) et la production brute standard (PBS), une variable estimant la taille de l’exploitation. Les strates ont été déterminées à l’aide d’un outil proposé par la direction de la Méthodologie de l’Insee. Ce travail a abouti à la création de près de 2 000 strates croisant Otex, taille et département géographique (lorsque le nombre d’unités était suffisant) ;
- la définition de la strate exhaustive dans laquelle sont placées les unités qui ne doivent pas faire l’objet d’une pondération lors de la production des résultats. L’objectif était, pour le recensement, d’élargir le périmètre des enquêtes Structure précédentes, où seules les très grosses exploitations figuraient. En effet, lors de l’enquête réalisée en 2016, la strate exhaustive était principalement constituée de 2 000 exploitations, celles dont la production brute standard dépassait 1,5 millions d’euros par an et celles employant au moins 50 salariés permanents. Toutes les autres exploitations agricoles faisaient l’objet d’une pondération, pouvant occasionner des problèmes de robustesse des résultats produits aux niveaux les plus fins. Les travaux réalisés pour le recensement de 2020 ont abouti à retenir deux seuils beaucoup plus bas : un seuil fixé à 250 000 € pour les exploitations en maraîchage, horticulture ou aviculture et un autre fixé à 500 000 € pour toutes les autres orientations. En complément, toutes les exploitations qui emploient au moins 10 salariés en emploi permanent sont également introduites dans la strate exhaustive. Au final, près de 25 000 unités ont été placées dans la strate exhaustive en raison de leur taille, soit plus de dix fois plus qu’en 2010. Les départements d’Outre-mer et de Corse ont également été placés dans la strate exhaustive. Ce choix a été motivé à la fois par la qualité des sources administratives, qui ne permet pas de constituer un univers complet avec des variables de stratification bien renseignées et par des effectifs limités qui auraient généré des taux de sondage très élevés. Enfin, les unités du réseau d’information comptable agricole (Rica), enquête statistique qui assure le suivi des revenus et des activités des exploitations, ont également été ajoutées à la strate exhaustive.
La collecte des 900 variables s’appuie largement sur les données administratives...
L’objectif du recensement agricole 2020 est de décrire les productions des exploitations, avec les superficies cultivées et les cheptels, ainsi que les principaux facteurs de production mobilisés en agriculture, en particulier la main-d’œuvre occupée et le mode de faire-valoir du foncier. Des questions portent également sur l’engagement dans des démarches spécifiques (démarches de qualité et ou environnementales), sur la diversification des activités et les modalités de commercialisation des produits.
Le questionnaire de 2020 s’appuie sur des informations déjà connues par ailleurs, par exemple avec le pré-remplissage des surfaces des cultures à partir des déclarations « PAC » (voir infra). En effet, pour réussir la collecte par internet, il était primordial d’alléger la charge de réponse pour les exploitants, et de diminuer la taille du questionnaire. Deux sources ont été notamment mobilisées :
- la base de données nationale d’identification animale (BDNI) sert de support à l’identification des animaux dans l’objectif d’assurer la traçabilité et le contrôle des aides européennes ; cette source permet de décrire le cheptel bovin élevé dans l’exploitation. Elle a été mobilisée pour les modules traitant de cette thématique ;
- les déclarations en vue de bénéficier d’une subvention européenne de la politique agricole commune (PAC), qui concernent trois quarts des exploitations françaises, sont également mobilisées pour renseigner les surfaces des cultures et l’intégralité du module « Développement rural », ce qui a simplifié considérablement le questionnaire pour ces unités.
... avec parfois quelques difficultés
L’appariement entre les unités recensées et les sources administratives a été réalisé sur le numéro d’établissement, le Siret. Cet identifiant est parfois mal renseigné dans les sources mobilisées, ce qui nécessite un contrôle approfondi lors de la constitution du fichier de lancement du recensement.
L’imputation des données PAC en lieu et place de la déclaration de l’agriculteur a par ailleurs amené trois types de problèmes. En premier lieu, des différences entre les nomenclatures de culture des données de la PAC et celle du recensement agricole obligent à poser des questions complémentaires pour certaines cultures. Par exemple, les cultures déclarées à la PAC en « Pomme de terre de consommation » doivent être éclatées entre « Pomme de terre primeur ou nouvelle », « Pomme de terre de conservation ou demi-saison » et « Plants de pomme de terre ». Les divergences de nomenclature sont particulièrement marquées pour les prairies, les légumineuses fourragères et les fruits. Une réflexion à moyen terme visant à mieux articuler la nomenclature PAC avec le questionnaire du recensement (qui est lui aussi issu d’un règlement européen) devrait aplanir les différences.
Deuxième difficulté, le taux de couverture par la PAC varie fortement selon les cultures, ce qui impose de compenser par des enquêtes supplémentaires.
Enfin, les données déclarées à la PAC varient parfois fortement avec celles déclarées par l’exploitant. Une comparaison entre les données PAC et les données déclarées dans l’Esea 2016 montre qu’entre 10 et 20 % des exploitations selon les cultures ont un écart en valeur absolue de plus de 5 % entre la déclaration PAC et l’enquête. Toutefois, ce constat ne préjuge pas de la qualité d’une source par rapport à une autre. Dans l’enquête, l’exploitant a tendance à arrondir les surfaces et il confond parfois les campagnes de cultures, donnant ainsi les surfaces de la campagne précédente ou de la campagne suivante.
Le recensement agricole c’est (vraiment) simple et rapide
Sur les 510 000 unités interrogées, 494 000 questionnaires ont été collectés, soit 97 % de retour sur l’ensemble du territoire national, en France métropolitaine comme dans les DOM. La collecte du recensement agricole 2020 est donc un franc succès (encadré 3). Elle a permis de porter cinq innovations qui touchent tous les acteurs de la collecte :
- les exploitants agricoles eux-mêmes (recours au multimode et aux données administratives, amélioration de la communication) ;
- les enquêteurs agricoles et les opérateurs des plateformes externes (formation en ligne, collecte par internet) ;
- et in fine les statisticiens (refonte du plan de sondage).
Encadré 3. Le recensement agricole 2020 en chiffres
- 7e recensement général s’adressant à toutes les exploitations agricoles depuis 1955
- 1 150 enquêteurs mobilisés dans le réseau de la statistique agricole
- 510 000 unités interrogées, 392 000 avec le questionnaire tronc commun, 118 000 avec le questionnaire complet dont 42 100 dans les DOM questionnaire complet dont 42 100 dans les DOM
- 490 000 questionnaires collectés avec 900 variables renseignées pour chaque exploitation agricole
- Collecte d’octobre 2020 à mai 2011
- Taux de réponse global (tronc commun et questionnaire complet) : 97 %
Activité des prestataires pour collecter le tronc commun
- 392 000 unités interrogées, 358 000 réponses collectées
- 145 000 connexions aux portails internet des prestataires
- 62 000 appels à l’assistance
- 800 000 courriers envoyés
- 950 000 courriels envoyés
- 480 000 SMS envoyés
Taux de retour sur le tronc commun
- 47 % de réponses par internet avec uniquement des relances automatiques
- 73 % de réponses après les relances téléphoniques
- 91 % après la collecte par téléphone par les prestataires
- 97 % après la collecte complémentaire par les Srise
Ce résultat conforte donc le SSP dans la plupart des choix qui ont été opérés en amont. En premier lieu, la flexibilité de la solution internet s’est révélée bien adaptée à l’activité des exploitants agricoles. Au final, seulement une réponse sur cinq a été obtenue par téléphone ou par courrier.
L’assistance par des opérateurs spécialement formés a été indispensable à la bonne participation par internet. En outre, la diversité des supports de relance (courrier, mail, SMS, téléphone) a permis une animation efficace de la collecte.
La relance par téléphone du réseau des enquêteurs agricoles, à l’issue du travail des prestataires, a été payante puisque 63 % des 35 000 non-répondants ont été récupérés. L’articulation entre les deux modes de collecte est donc efficace.
Les phases de relance par téléphone et d’interviews par téléphone sont complémentaires et peuvent se dérouler simultanément, en gérant l’orientation dans chacune des phases avec des priorités. En phase de relance, un exploitant qui ne peut pas ou ne veut pas répondre par internet doit pouvoir être interrogé immédiatement par téléphone. En phase d’interrogation, une personne qui affirme vouloir répondre par internet ne répondra pas par téléphone, même en insistant.
La durée du questionnaire varie selon les caractéristiques de l’exploitation agricole et selon le mode de réponse, mais il reste toujours dans des normes acceptables :
- les mises en hors champs sont très rapides (5 minutes) ;
- à l’inverse, les exploitations pour lesquelles aucune déclaration PAC n’a pu être retrouvée mettent plus de temps pour répondre : elles doivent passer en revue toutes les productions, aucune information ne pouvant être chargée sur les surfaces ;
- le questionnaire est plus rapide en passation par téléphone (22 minutes) qu’en durée de connexion sur internet (28 minutes) ;
- la durée varie également selon l’orientation de l’exploitation, allant, pour la collecte par téléphone, de 18 minutes pour les grandes cultures ou les éleveurs de bovins à 24 minutes pour les éleveurs d’ovins-caprins.
De cette édition 2020 ressort également un ensemble de points de vigilance ou d’améliorations à envisager pour les prochaines collectes.
Un élément déterminant pour assurer un bon taux de réponse est de disposer du maximum de coordonnées sur l’unité interrogée. La recherche manuelle de coordonnées complémentaires permet de gagner quelques points de participation. Elle est certes coûteuse, car réalisée par un gestionnaire d’enquête, mais devrait rester moins onéreuse que le face-à-face.
En mode auto-administré, plusieurs questions courtes et simples sont parfois préférables à une seule question longue et complexe, surtout via internet où la lecture sur l’écran se fait rapidement. Les contrôles embarqués permettent de garantir une bonne qualité des données, mais ils doivent être bien calibrés compte-tenu de la très grande diversité des situations rencontrées.
Certains exploitants ne se sont pas sentis concernés par le recensement agricole et n’ont donc pas répondu spontanément au questionnaire. C’est le cas par exemple de certains viticulteurs ou apiculteurs. Une communication les incluant plus spécifiquement, serait à développer pour le prochain recensement agricole.
En complément des solutions d’assistance proposées en cours de collecte, un répondeur vocal pourrait raconter les étapes à venir et expliquer les solutions possibles pour répondre.
L’organisation retenue a mis en œuvre trois applications de saisie (deux pour les prestataires et une pour le SSP). Cela a généré une charge très importante pour spécifier, suivre le développement et valider le fonctionnement de chacune d’entre elles. La réalisation d’une application unique pour tous les acteurs intervenant dans la collecte paraît aujourd’hui plus optimale, et mériterait en tout cas d’être étudiée.
Le contexte de tous les travaux réalisés en trois ans, depuis la préparation jusqu’à la fin de la collecte, a été évidemment marqué par la crise sanitaire. Cela n’a pas empêché le bon déroulement du protocole : le recensement de 2020, avec son cortège de nouveautés, débouche fin 2021 sur une couverture très efficace de l’univers agricole.
La diffusion s’accompagne d’une sixième innovation. Une data visualisation présente les premiers résultats sur tous supports, en particulier sur smartphone. Elle s’appuie sur des techniques qui mélangent graphiques et explications : les parties significatives du visuel sont mises en évidence ou zoomées au gré du défilement de la page commandé par l’utilisateur (Ouvrir dans un nouvel ongletSSP, 2021). L’objectif de ce mode de diffusion est de toucher tous les publics, et en tout premier lieu, les agriculteurs.
Fondements juridiques
Ouvrir dans un nouvel ongletRèglement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles. In : site EUR-Lex. [en ligne]. [Consulté le 10 décembre 2021].
Paru le :20/01/2022
FAO (Food and Agriculture Organization).
Voir les références juridiques en fin d’article.
In fine, 13 % des exploitations agricoles ont été classées hors champ du recensement agricole, essentiellement en raison de cessation d’activité ou d’activité interrompue.
Le service statistique ministériel de l’Agriculture est constitué du Service de la statistique et de la prospective (SSP) et des Services régionaux de l’information statistique et économique (Srise).
Le casier viticole informatisé (CVI) est un outil que les États membres de l’Union européenne doivent tenir obligatoirement. Il contient notamment toutes les informations relatives aux entreprises viti-vinicoles, aux parcelles plantées ou arrachées, les niveaux de production et de stock. En France, ce répertoire est géré par les services des douanes.
La statistique agricole mobilise de longue date un réseau d’enquêteurs, pour la plupart issus du monde agricole.
Voir les adaptations apportées à la collecte dans les départements d’Outre-mer dans l’encadré 2.
En toute rigueur on devrait parler de quatre modes, puisqu’un peu moins de 600 questionnaires ont été collectés sur support papier. La plupart n’ont d’ailleurs pas pu être saisis sans le recours à des enquêteurs qui ont dû rappeler les exploitants pour compléter leur réponse.
Il s’agit de BVA et Ipsos.
Hors la Corse qui a été recensée exclusivement en face-à-face, par les enquêteurs du Srise (voir infra).
Enquête statistique annuelle permettant un suivi longitudinal de l’occupation et de l’usage du sol au niveau national, régional et départemental (mode de consommation des terres agricoles et des espaces naturels, artificialisation et imperméabilisation des sols) et la quantification des principaux flux entre grands types d’occupation. Voir Ouvrir dans un nouvel onglethttps://www.cnis.fr/enquetes/occupation-et-lutilisation-du-territoire-teruti-enquete-sur-l-2020a063ag/.
La plate-forme utilisée est en open source (Ouvrir dans un nouvel ongletMoodle, 2021).
Ces modules ne sont visibles que pour les enquêteurs des DOM.
Voir (Ariely, 2010), (Kahneman, 2012) et (Thaler et Sunstein, 2012).
Ce groupe de travail a été mis en place par un des prestataires sélectionné pour la collecte par téléphone, car il avait en la matière une certaine expérience.
Il s’agit de la fonction R Palourde, qui automatise les calculs de l’algorithme Koubi-Mathern afin de déterminer le nombre d’unités à interroger dans chaque strate. Les variables de stratification ont ensuite été découpées de manière optimisée en appliquant la méthode Lavallée-Hidiroglou pour le calcul des bornes de stratification.
Trois surfaces sont enregistrées à la PAC et figureront dans le fichier de diffusion : la surface graphique qui correspond à la réalité du terrain, i.e. la surface de la culture réellement en place, la surface admissible qui est une surface recalculée intégrant les bordures considérées comme cultivées, et la surface constatée, qui sert d’assiette au calcul de la subvention.
Les premiers résultats ont été publiés en décembre 2021. Voir par exemple (Ouvrir dans un nouvel ongletBarry et Polvêche, 2021).
Pour en savoir plus
ARIELY, Dan, 2010. Predictably Irrational : The Hidden Forces That Shape Our Decisions. 27 avril 2010. Éditions Harper Perennial. ISBN 978-0061353246.
BARRY, Catherine et POLVÊCHE, Vincent, 2021. Ouvrir dans un nouvel ongletRecensement agricole 2020. Surface moyenne des exploitations agricoles en 2020 : 69 hectares en France métropolitaine et 5 hectares dans les DOM. [en ligne]. Décembre 2021, SSP, Agreste n° 5. [Consulté le 10 décembre 2021].
CNIS, 2019. Ouvrir dans un nouvel ongletRecensement agricole 2020. [en ligne]. 17 octobre 2019. Avis d’opportunité N° 146/H030 modifié. [Consulté le 10 décembre 2021].
CNIS, 2020. Ouvrir dans un nouvel ongletRecensement agricole 2020. [en ligne]. 28 mai 2020. Comité du label de la Statistique publique. N° 2020_11698_DG75-L002. [Consulté le 10 décembre 2021].
DITP, 2021. Ouvrir dans un nouvel ongletSimplifier les documents administratifs. In : site de la DITP. [en ligne]. 22 février 2021. Ministère de la Transformation et de la Fonction Publiques. Équipe sciences comportementales. [Consulté le 10 décembre 2021].
EUROSTAT, 2020. Ouvrir dans un nouvel ongletLe recensement agricole 2020. In : site d’Eurostat. [en ligne]. [Consulté le 10 décembre 2021].
FAO, 2020. Ouvrir dans un nouvel ongletProgramme du recensement mondial de l’agriculture 2020. In : site de la FAO. [en ligne]. Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. [Consulté le 10 décembre 2021].
KAHNEMAN, Daniel, 2012. Système 1 / Système 2 – Les deux vitesses de la pensée. Paris, éditions Flammarion, Collection Essais. Traduction de Raymond Clarinard. ISBN 2-08-121147-5.
MOODLE, 2021. Ouvrir dans un nouvel ongletDocumentation de Moodle 3.x. In : site de Moodle. [en ligne]. Mis à jour le 14 juillet 2021. [Consulté le 10 décembre 2021].
SSP, 2010. Ouvrir dans un nouvel ongletRecensement agricole 2010 – Premières tendances. In : Agreste Primeur – France métropolitaine. [en ligne]. Septembre 2011. Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire. N° 266. [Consulté le 10 décembre 2021].
SSP, 2021. Ouvrir dans un nouvel ongletVIZagreste, les résultats de la statistique agricole en datavisualisation. [en ligne]. Décembre 2021. Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. [Consulté le 10 décembre 2021].
THALER, Richard et SUNSTEIN, Cass, 2010. Nudge : la méthode douce pour inspirer la bonne décision. Mars 2010. Paris, éditions Vuibert, collection Signature. Traduction de Marie-France Pavillet. ISBN 978-2-311-00105-1.